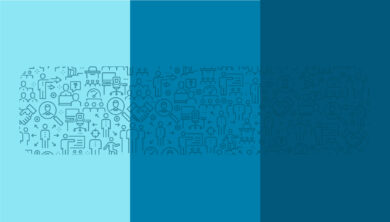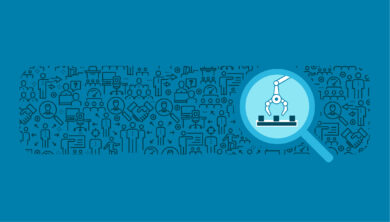« Il est possible de faire de chaque boulot un bon emploi; le problème, c’est que nous décidons simplement de ne pas agir en ce sens. » Comment améliorer le travail dans l’économie canadienne des petits boulots
Enjeux en action | La nature changeante du travailEnjeux en action
Cette étude de cas illustre les sujets du rapport de Laura Lam au sujet de la précarité du travail atypique
Au moment de l’impact, Ahmad savait qu’il avait de la chance d’être encore en vie.
« Le casque que je portais s’est complètement disloqué », raconte le réfugié syrien de 36 ans qui a élu domicile à Toronto depuis cinq ans. « J’avais deux commandes sur moi au moment de l’accident. Je faisais des livraisons à l’époque. »
L’accident en question s’est produit en octobre 2020, sur la Bloor Street, une voie de circulation très achalandée du centre-ville de Toronto, près de High Park. Ahmad, qui nous a demandé de ne pas dévoiler son nom de famille, transportait des plats cuisinés pour Uber Eats, Skip the Dishes et DoorDash. Il circulait sur son vélo électrique lorsque le conducteur d’une voiture – également un chauffeur Uber – est sorti d’une place de stationnement sans le voir. Les blessures à la tête d’Ahmad l’ont obligé à s’absenter du travail pendant deux semaines pour récupérer. Or, pendant ces deux semaines, il n’a pas été payé.
« Je n’ai reçu aucune aide pour mes revenus perdus », révèle Ahmad, qui admet avoir eu du mal à régler son loyer mensuel de 1 500 dollars. « Il n’y a personne pour nous protéger ou nous aider. Aucune prestation de maladie n’est prévue. Les entreprises de l’économie des petits boulots ne considèrent pas les personnes qui travaillent pour elles comme le font les autres secteurs. Elles vous désignent comme un pigiste ou un entrepreneur : vous n’avez donc aucun droit en tant qu’employé. »
Livrer de la nourriture n’est pas exactement la carrière dont Ahmad rêvait. Il a étudié cinq ans en Syrie pour devenir ingénieur électricien avant d’être obligé de fuir le pays. Toutefois, ses compétences ne sont pas transférables ici au Canada et, comme des milliers d’autres personnes dans sa situation, il a été contraint d’accepter un boulot avec peu ou pas de sécurité d’emploi.
« Il n’y a pas de stabilité dans mes revenus, dit-il. Certains jours, il y a beaucoup de commandes et c’est occupé, alors que d’autres jours, c’est la dèche. Il faut donc économiser en prévision des mauvais jours. »
« Il est difficile d’obtenir un prêt hypothécaire, de planifier sa semaine et d’élever une famille dans de telles circonstances », d’expliquer Brian Topp, stratège politique canadien, membre du Forum des politiques publiques et ancien directeur général de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) de Toronto – le syndicat représentant les artistes canadiens du cinéma et de la télévision.
« Le stress et l’incertitude de l’emploi précaire, ajoute M. Topp, sont très éprouvants pour ces personnes, et ont un effet délétère sur leur santé. »
Leçons de l’industrie cinématographique pour l’économie des petits boulots
Au Canada, des millions de personnes à revenu modeste ont un emploi précaire, souvent au sein de l’économie des petits boulots. Les emplois dans les secteurs des petits boulots, comme le covoiturage et la livraison de nourriture, sont souvent peu stables. Ils sont mal rémunérés et dépourvus d’avantages sociaux comme de régimes de retraite. Et les normes d’emploi y sont rares.
On prévoit que le marché du travail canadien comportera davantage d’incertitude et d’instabilité après la pandémie. Voilà pourquoi les défenseurs des droits du travail comme Brian Topp affirment que le Canada devrait s’inspirer des réussites passées pour forger une nouvelle voie menant à davantage de prospérité. L’une de ces réussites, selon M. Topp, s’incarne dans l’industrie cinématographique canadienne.
« [L’industrie du cinéma] est très précaire, précise M. Topp. On peut vous engager pour un seul jour, peut-être deux ou trois, voire une semaine ou un mois si vous faites partie des artistes les plus populaires. »
Depuis des décennies, l’industrie cinématographique lutte pour obtenir de meilleurs salaires. Dans les années 1940, les artistes de la radio ont ainsi créé un collectif appelé RATS (Radio Artists Toronto) dont le slogan était We want a dollar a holler. Il s’agissait d’un mouvement syndical précoce qui a permis aux artistes de se faire entendre et de réclamer l’équité au travail. Le collectif était l’ancêtre de l’association connue aujourd’hui sous le nom d’ACTRA.
« Ce qui différencie les gens du cinéma des autres travailleur.euse.s précaires, c’est qu’on y retrouve des gens qui ont un certain pouvoir », explique Brian Topp. On parle ici d’acteur.trice.s que les réalisateurs voulaient engager. Que leurs fans acclamaient. C’étaient donc des personnes influentes.
« Ces personnes ont utilisé le pouvoir de marché qu’elles détenaient, non seulement pour obtenir de meilleures conditions pour elles-mêmes, mais aussi pour doter une association de travailleur.euse.s précaires de moyens d’agir, avec comme mission de fixer des normes pour tou.te.s dans chaque catégorie d’emploi, y compris les personnes qui n’avaient pas d’influence. »
Pour travailler dans l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision, les artistes doivent être membres de l’ACTRA, qui protège leurs droits. Les membres paient des cotisations syndicales et participent à un REER, ce qui leur permet de se constituer un fonds de retraite. C’est un aspect clé, car le revenu moyen d’un artiste de la scène est d’environ 14 000 $ par an au Canada.
« Les artistes évoluent donc désormais dans un monde où ils contribuent à leur fonds de pension et à leurs avantages sociaux d’un contrat à l’autre, explique M. Topp. Ils ou elles peuvent travailler pour cinq, dix ou quinze employeurs dans une année, mais tous contribuent au même régime. »
Le champ d’action de l’ACTRA s’est étendu aux autres personnes travaillant sur les plateaux. En effet, des syndicats représentent désormais non seulement les artistes, mais aussi les gens de métier, les artisan.e.s et les machinistes, entre autres. Cela contribue à faire de l’ensemble de l’industrie un marché équitable.
« Dans un contexte où nous essayons de déterminer comment les travailleur.euse.s indépendants pourraient bénéficier de normes du travail, il est capital d’entretenir un dialogue soutenu et approfondi avec les organisations existantes, comme l’ACTRA, qui représentent les employé.e.s pigistes et qui ont eu beaucoup de succès dans ce domaine », déclare Karl Pruner, directeur des communications d’ACTRA Toronto et acteur à la retraite.
Karl Pruner, qui a décroché son premier gros rôle dans les années 1990 alors qu’il jouait dans la série télévisée canadienne E.N.G., estime que le Canada doit donner à l’ensemble des travailleur.euse.s de tous les secteurs d’activité la possibilité de se faire entendre. « Nous ne prônons pas l’abolition du capitalisme ou quelque chose du genre. Nous énonçons simplement un fait reconnu : dans la plupart des lieux de travail de nos jours, pour améliorer la vie des travailleur.euse.s, vous devez d’abord vous adresser à eux. »
Selon Brian Topp, certains secteurs de l’économie des petits boulots nécessitent des réformes urgentes. Il estime qu’une réorientation des politiques publiques est nécessaire dans deux domaines principaux : les normes d’emploi minimales prescrites par le gouvernement et la transformation des petits boulots en bons emplois – par la conclusion de conventions collectives volontaires ou obligatoires.
« Chaque employé.e, qu’il/elle soit pigiste ou à temps plein, devrait avoir droit à un traitement prévoyant toujours une contribution à des avantages sociaux sous une forme ou une autre. Qu’il s’agisse d’un régime public ou d’un régime coopératif, l’employeur devrait en assumer la responsabilité. »
Laura Miller, responsable des politiques publiques et des communications chez Uber Canada, affirme que c’est exactement ce que son entreprise tente de faire. Elle explique que, dans un récent sondage mené auprès des chauffeur.se.s et des livreur.se.s Uber, 74 % d’entre eux, comme Ahmad, considèrent la flexibilité et l’indépendance comme les meilleurs côtés de leur travail. Cependant, 81 % des personnes sondées souhaitent également que cette flexibilité s’accompagne d’avantages sociaux. Par conséquent, en mars, Uber Canada a déposé une proposition appelée Flexible Work+ qui créerait un fonds d’avantages sociaux autogéré pour les gens qu’elle emploie, en fonction des heures travaillées. Ce fonds permettrait à ces personnes de retirer de l’argent pour des avantages tels que les soins dentaires, les soins de la vue, les REER ou l’éducation.
« Il s’agit une approche moderne de l’économie à la tâche pour le Canada », déclare Laura Miller. Cette proposition est à même de créer un meilleur avenir pour le travail indépendant, en exigeant que les entreprises de plateforme comme Uber contribuent à des fonds que les personnes à leur emploi peuvent dépenser en avantages sociaux. »
Selon Mme Miller, le plan ne fonctionnera que si les gouvernements provinciaux modifient les lois régissant la rémunération à la tâche dans le secteur des applications afin que toutes les entreprises, et pas seulement Uber, soient obligées d’offrir ces nouveaux avantages et ces nouvelles protections d’emploi. Selon elle, ce plan aiderait les travailleur.euse.s à cumuler des avantages sociaux, quelle que soit l’application pour laquelle ils/elles travaillent à un moment donné, à l’instar d’un régime d’avantages sociaux transférables. Si un régime comme Flexible Work+ était imposé à l’échelle du Canada, Uber estime que l’entreprise débourserait à elle seule 40 millions de dollars canadiens en avantages sociaux par an.
Faire des petits boulots de bons emplois
Pour sa part, Ahmad prévoit pour l’instant continuer son boulot de livreur, en partie parce qu’il est pessimiste quant à son avenir professionnel. « Ce n’est pas facile. La seule chose que je puisse faire est d’aller étudier dans un collège. Même à cela, le serais probablement obligé de me dégoter un travail pour lequel les qualifications requises sont inférieures à mon diplôme [d’ingénieur électrique]. »
Cependant, même sans avantages ni protections, il affirme que son travail actuel lui convient, parce que « je ne suis pas obligé de travailler de neuf à cinq; je choisis de faire ça pour le moment parce que j’ai besoin de liberté ».
Brian Topp s’inquiète également du fait que, tant que le secteur ne changera pas, la liberté dont jouit Ahmad aura un prix chèrement payé.
« S’il vous prend l’envie de siroter un café pendant votre journée de travail, vous êtes bien sûr libre de le faire, déclare M. Topp, mais si vous voulez gagner votre vie, vous devrez travailler très dur, en [mettant en jeu] à la fois votre revenu et le capital nécessaire pour exploiter votre entreprise. Voilà qui semble être une relation très inégale, et on peut se demander si c’est une bonne affaire pour la plupart des gens. »
« Nous n’avons pas à abandonner la stabilité pour la flexibilité », déclare pour sa part Kaylie Tiessen, chercheuse et représentante nationale d’UNIFOR, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. « Si nous mettons en place un meilleur système, les employé.e.s pourraient avoir la flexibilité requise pour jouir du mode de vie qu’ils/elles préfèrent, tout en bénéficiant en même temps d’un emploi stable. »
Selon Mme Tiessen, il faudrait examiner de plus près les normes prescrites par le gouvernement et celles accordées par les employeurs, et veiller à ce que toutes soient appliquées.
« Nous devons nous assurer que les travailleur.euse.s ont la possibilité de se syndiquer et qu’ils acquièrent un pouvoir de négociation décisif afin d’avoir plus d’influence sur leurs conditions de travail. Nous avons besoin de politiques comme un salaire minimum plus élevé et des jours de maladie payés.
« Il est donc possible de faire de chaque boulot un bon emploi; le problème, c’est que nous décidons simplement de ne pas agir en ce sens », de conclure Kaylie Tiessen.
Brian Topp implore le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux de travailler de concert après la pandémie pour coordonner une réponse à l’économie des petits boulots, qui est en pleine expansion.
« Les petits boulots ne sont pas près de disparaître; en fait, il est probable qu’ils iront plutôt en se multipliant. La question est donc de savoir à quelles conditions. Est-il possible d’avoir une plus grande proportion de boulots, petits et grands, qui soient réellement de bons emplois, ou l’économie à la tâche est-elle un racket unidirectionnel visant à appauvrir encore plus de gens? »
Merci à nos partenaires
Nous remercions notre partenaire principal

Merci à nos partenaires
 |
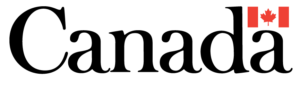 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |