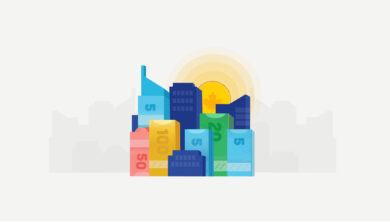Les relations canado-américaines : un tango compliqué
par Drew FaganIl y a presque 50 ans, un vendredi 13, un président américain connu pour ses caprices a ourdi une stratégie qui allait porter un coup aux institutions de l’après-guerre dont avaient découlé 25 années de paix et de prospérité.
Richard Nixon a annoncé ces mesures en août 1971, sans en aviser préalablement le Canada. Les étapes prévues pour mettre effectivement fin au système de taux de change fixe de Bretton Woods et imposer un tarif supplémentaire de 10 % sur les produits étrangers importés aux É.‑U. devaient servir à stimuler une économie affaiblie par un taux de chômage élevé et une inflation galopante. Mais elles ont proprement atterré les alliés des É.-U.
Les appels du Canada étant demeurés lettre morte, la réponse politique canadienne connue sous le nom de Troisième option a vu le jour. Aujourd’hui, il serait bon de réexaminer cette politique alors que le Canada est à nouveau confronté aux caprices du président américain, dont le slogan « America First » (l’Amérique d’abord) a suscité une incertitude sans précédent.
Annoncée en 1972 par le gouvernement de Pierre Trudeau, la stratégie de la Troisième option préconisait une réduction de l’influence économique et culturelle des É.-U.
Le status quo avait été rejeté (Option 1), de même que l’Option 2 (l’établissement de liens plus étroits avec les É.-U.). On a donc mis en place une troisième option pour diminuer la vulnérabilité du Canada en diversifiant le commerce et en renforçant une économie canadienne distincte. L’objectif était de créer des « contrepoids » sans être anti-américain.
L’histoire a consigné les résultats de cette stratégie. À cette époque, 60 % du commerce du Canada dépendait des États‑Unis. Bien que le Canada avait signé un « lien contractuel » avec la Communauté économique européenne, le commerce avec le l’Europe demeurait limité. Lorsque le gouvernement libéral a été vaincu, en 1984, les exportations à destination des États‑Unis se situaient à environ 75 %. Cependant, Washington estimait que certaines politiques nationales, comme la création de l’Agence d’examen de l’investissement étranger et, ensuite, le lancement du Programme énergétique national, étaient anti‑américaines. Puis, le gouvernement progressiste‑conservateur de Brian Mulroney est passé à la deuxième option : le libre‑échange. En 2020, les exportations vers les États-Unis demeurent à environ 75 %, mais au sein d’une économie bien plus axée sur le commerce que par le passé0F0F[1].
Aujourd’hui, le Canada entretient une relation encore plus complexe avec les États-Unis. En effet, les profondes divisions qui touchent la société américaine se sont creusées d’autant plus en raison de la crise de la COVID-19. Le système politique qui avait un jour engendré la bi‑partisanerie a attisé l’extrémisme, surtout du côté républicain1F1F[2]. Un sentiment de doléances envers les alliés du pays a été mené à son paroxysme par le président américain Donald Trump, et risque de demeurer, du moins au sein de certaines politiques, lorsque celui-ci quittera ses fonctions. Même après la ratification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), qui a remplacé l’Accord de libre-échange nord‑américain (ALENA), Washington a brièvement ré‑imposé des tarifs sur l’aluminium canadien sous le prétexte, rarement invoqué avant la présidence de Trump, que la sécurité nationale des É.-U. était en jeu.
Il semblerait qu’une Amérique acrimonieuse et centrée sur elle-même laisse moins d’espace politique à une nation comme le Canada2F2F[3]. Alors, que faire? Surtout qu’une élection présidentielle, qui risque fort d’être la plus décisive de l’histoire, approche à grands pas?
Pour commencer, Ottawa est déterminé à ne pas être pris au dépourvu, comme en 2016, lorsque Trump a pris le pouvoir. Le gouvernement libéral n’était pas le seul dans cette situation : les gouvernements du monde entier ont aussi fait des pieds et des mains pour avoir accès aux personnes évoluant dans l’orbite de Trump. Et actuellement, on élabore toutes sortes de scénarios, et tout le monde cherche à atteindre les joueurs clés des campagnes républicaine et démocrate.
C’est généralement le titulaire du poste qui est la valeur connue de l’équation. Mais la capacité apparemment infinie de Trump d’élaborer des politiques réactionnaires, c’est-à-dire visant à profaner le réel et le perçu et à susciter l’extrémisme, rend la planification d’un deuxième mandat de Trump particulièrement difficile.
Par contraste, le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, est un joueur bien connu de Washington, ayant été élu pour la première fois au Sénat en 1972. Comme il l’a dit lors de son passage à Ottawa à la fin de 2016, lorsque son mandat de vice-président touchait à sa fin, il n’a pas travaillé seulement avec Justin Trudeau, il a travaillé avec Pierre Trudeau.
Pour le Canada, le pire scénario, du moins dans l’immédiat, concerne le processus électoral et la possibilité que l’issue de l’élection du 3 novembre ne soit pas acceptée.
Pour les représentants canadiens, cette situation est « épineuse ». Il n’est pas difficile d’envisager la violence possible avant, pendant et après les élections, surtout en raison des tensions partisanes, des obstacles suscités par la tenue d’un scrutin durant une pandémie, des manifestations liées aux inégalités raciales organisées par le mouvement Black Lives Matter et des contre-manifestations connexes.
Tout cela pourrait entraîner une incertitude économique supplémentaire aux États-Unis, déjà confrontés au pire ralentissement depuis la Dépression, secouer les perspectives économiques du Canada et, dans une situation extrême, ramener un flux de demandeurs d’asile aux frontières du Canada. Or, comme le pilier central de l’économie canadienne est fixé dans la stabilité canadienne au sein d’un espace économique nord-américain stable, les fondements de ce pilier s’effondreraient.
Les Canadiens étaient aux aguets durant la soirée électorale de 2000 alors que le scrutin était non concluant. Il a fallu cinq semaines à la Cour suprême pour mettre réellement fin au recomptage des votes de la Floride et établir que George W. Bush devançait Al Gore de 537 votes. Refusant tout d’abord cette décision, Gore a fini par admettre le résultat. Le président Bill Clinton est, pour sa part, resté hors de la mêlée. (Le Canada a reçu une certaine attention à titre de contrepoint en raison d’une élection fédérale antérieure, à l’issue de laquelle le décompte des bulletins avait, comme toujours, pris quelques heures.)
Trump a refusé de façon éloquente de dire s’il admettrait l’issue du scrutin dans des circonstances similaires, et ses efforts visant à délégitimiser le vote par correspondance postale ont intensifié les tensions. Près du quart des bulletins de vote ont été déposés de cette façon en 2016, et on s’attend à un pourcentage plus élevé cette année, surtout chez les minorités visibles et les pauvres. Imaginons un scénario dans lequel Trump mènerait la course durant la soirée électorale, surtout à cause des bulletins déposés dans les bureaux de vote, mais qu’il faille du temps pour compter les bulletins envoyés par la poste en raison de retards de la poste américaine et qu’en bout de ligne, Biden prenne la tête. Il est peu probable que Trump adopte une attitude aussi magnanime que celle de Gore ou aussi détachée que celle de Bill Clinton3F3F[4].
Si le pire des scénarios est celui du chaos électoral, ou quelque chose de similaire, le scénario probablement négatif est celui d’un second mandat de Trump. Or, ce résultat ne serait pas entièrement néfaste. En effet, Trump a fini par signer l’ACEUM en dépit de ses vertes critiques envers le Canada pour ses pratiques supposément déloyales et son parasitisme en matière de sécurité, et il faut bien reconnaître que le commerce bilatéral a augmenté sous le mandat de Trump, du moins jusqu’à ce que la pandémie frappe.
De plus il soutient catégoriquement le pipeline de Keystone, alors que Biden s’y oppose. Et les restrictions de Trump en matière d’immigration, plus particulièrement en ce qui concerne l’octroi de visas dans le secteur technologique, a été une véritable bénédiction pour le Canada, car les talents étrangers regardent maintenant vers le Nord.
Cependant, une victoire de Trump prolongerait probablement la pandémie à cause de son refus de mobiliser toute la puissance du gouvernement des É.-U. Selon les décideurs canadiens, la frontière canado-américaine n’est pas tant fermée, du moins à la majorité des voyageurs, et parfois même au commerce, qu’« adaptable selon les besoins ». Mais le fait que la frontière la plus libre au monde soit tout sauf ouverte demeure corrosif. Toute circonstance dans laquelle cette situation serait considérée comme normale pèserait lourdement sur un pays qui est plus dépendant d’un marché que de tout autre grand pays industrialisé et dont près de 90 % des résidents demeurent dans un rayon de 150 kilomètres de la frontière.
Le scénario probablement positif est celui d’une victoire de Biden, mais ce n’est pas non plus une panacée, et de loin. Contrairement à Trump, qui semble considérer la géopolitique dans l’optique des transactions à somme nulle, Biden a consacré toute sa carrière à Washington à concevoir un consensus bipartisan. Dans la même mesure, il éliminera une grande partie de l’incertitude qui entache actuellement la relation bilatérale. Mais les considérations d’ordre national des É.-U. ont rarement été aussi puissantes à l’encontre des intérêts des pays étrangers, dont le Canada.
La politique d’approvisionnement de 400 milliards de dollars (américains) de Biden « Buy American » (Acheter américain) serait un véritable défi pour l’industrie canadienne. La détermination de Biden face à la politique industrielle n’est pas sans rappeler celle du gouvernement libéral, mais l’envergure des investissements prévus en R-D (300 milliards de dollars pour la technologie 5G, l’intelligence artificielle et d’autres secteurs avant-gardistes) représenterait un défi concurrentiel pour le Canada.
Première tâche pour Ottawa avec une administration Biden : veiller à ce que le plan « Build Back Better » (reconstruire en mieux) de Biden se fasse dans une perspective plus continentale, même si l’état d’esprit prédominant est centré sur les É.-U. En une décennie, les temps ont changé, mais un plan d’approvisionnement similaire à l’ère d’Obama s’était soldé par une plus grande participation du Canada, lorsque les provinces et les territoires ont ouvert leurs propres marchés d’une façon similaire à celle de la majorité des États américains4F4F[5].
Le document exposant la Troisième options s’intitulait « Relations canado‑américaines : choix pour l’avenir »5F5F[6]. Son auteur préconisait l’intégration Canada–États-Unis à la place d’une politique nationale activiste et des liens plus étroits avec les autres pays.
Mais cela n’a pas besoin d’être un choix.
La diversification du commerce et des liens d’investissement du Canada ne doit pas servir à réduire la dépendance de notre pays au marché américain. Elle doit servir à mieux exploiter d’autres marchés tout en continuant de saisir les occasions qui se présentent du côté des États‑Unis.
Le Canada ne peut pas se permettre le luxe d’un plan B. Il a seulement un plan A qui associe une politique nationale efficace à des approches réalistes des politiques canado-américaine et étrangère mieux adaptées à l’ère du retranchement des É.-U. et du changement à l’échelle planétaire. À savoir :
Le record de productivité enregistré ces dernières années au Canada a devancé de beaucoup la performance moyenne des pays industrialisés de l’OECD, et encore plus celle des États-Unis. Il y a trente ans, l’économie canadienne correspondait presqu’exactement à un dixième de celle des États-Unis. Elle représente aujourd’hui moins d’un douzième, à 8,1 %6F6F[7]. L’Ontario, qui demeure le cœur industriel du Canada, possède un PIB par habitant équivalent à celui de sept États américains avoisinants il y a 40 ans, mais est maintenant en retard sur tous ces États, un peu par rapport au Michigan et plus par rapport à l’Ohio et la Pennsylvanie. Le PIB par habitant de New York est supérieur de non moins de deux tiers7F7F[8].
Cependant, le commerce interprovincial du Canada est faible par rapport au commerce canado‑américain. Le premier est ralenti par des barrières commerciales interprovinciales qui, selon une étude menée par Statistique Canada en 2019, représentaient l’équivalent d’un tarif de 10 %. Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé qu’un réel libre-échange interprovincial permettrait d’accroître de 4 % le PIB du Canada8F8F[9].
Comme on l’a relevé dans le cadre de la Troisième option il y a bien des années, rien ne peut remplacer une économie canadienne forte en termes d’édification de la capacité et de la crédibilité internationales, et une économie canadienne forte est dans l’intérêt des É.-U.
Il n’est pas pertinent de faire une analyse détaillée des affaires nationales dans un article sur le Canada et une Amérique en pleine évolution, mais un important levier politique mérite toutefois d’être souligné : l’infrastructure.
Le plan d’infrastructure fédéral de 187 milliards de dollars est clairement et selon toutes probabilité axé sur une infrastructure durable et résiliente. Cependant, il y a au Canada quelques secteurs tout aussi balkanisés, notamment la transmission d’énergie propre. Une priorisation nationale des réseaux Est-Ouest correspondrait au programme écologique d’Ottawa et serait le type de projet national susceptible de stimuler l’économie nationale, à l’instar du CFCP ou de la voie maritime du Saint-Laurent 9F9F[10]. Elle serait probablement aussi accueillie à bras ouverts à Washington au début du mandat de Biden, le cas échéant, du fait que les États-Unis chercheraient à revenir sur la voie de la conformité à l’Accord Paris.
Le plan d’infrastructure d’Ottawa est aussi fortement axé sur le commerce et le transport internationaux. La construction du pont international Gordie-Howe entre Detroit et Windsor est l’exemple le plus notoire pour lequel le Canada paie la note. L’administration Trump n’a pas réussi à promulguer un plan d’infrastructure. Mais il est probable que toute stratégie économique américaine établie suite à la pandémie comportera un volet d’infrastructure solide, y compris le développement de la large bande. Ici également, il est probable qu’elle soit fortement orientée vers un approvisionnement national.
Durant les années à venir, les dépenses en infrastructure des deux côtés de la frontière croîtront, car les deux pays tentent actuellement de rattraper des décennies de sous-investissement. Le Canada, qui a une longueur d’avance au chapitre de l’expertise, plus particulièrement en ce qui concerne les partenariats public-privé, devrait essayer de tirer parti de cet aspect pour conserver une forte présence sur le marché de plus en plus protectionniste des É.-U.
La Troisième option a été annoncée lorsque les États-Unis représentaient un peu plus du tiers du PIB mondial. Ce pourcentage s’élève aujourd’hui à moins d’un quart. Il n’en reste pas moins que le Canada profite du fait d’avoir une grande partie du monde à sa porte et semble souvent prendre cet aspect pour acquis. Comme un haut fonctionnaire canadien le faisait récemment observer : « Nous semblons parfois penser que nous avons obtenu notre avantage géographique grâce à une bonne politique gouvernementale ».
Par exemple, le Canada est le principal partenaire commercial de l’État de New York, dont le PIB est équivalent à celui de l’Australie; il en va de même pour le Colorado, dont l’envergure économique est comparable à celle de Singapour.
La relation commerciale bilatérale du Canada avec les É.-U., même dans la foulée de la ratification de l’ACEUM, demeure en grande partie telle qu’elle l’a été depuis plus de 30 ans. Les É.-U. imposent certes des tarifs sur des produits politiquement sensibles (l’aluminium récemment, le bois d’œuvre à maintes reprises), mais la vaste majorité du commerce continue sans anicroche. Durant les premières années du libre-échange, c’est du domaine de l’automobile et des pièces automobiles qu’émanait la plus forte croissance. Puis, le secteur du gaz et du pétrole a pris la relève. Aujourd’hui, c’est le domaine des services qui arrive en tête.
De façon plus générale, il est primordial que le Canada conserve la bonne organisation de sa stratégie fondée sur la participation de tous en vue des négociations de l’ACEUM. Cette stratégie fait intervenir de multiples ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des dirigeants municipaux (étant donné les liens transfrontaliers croissants concernant la politique urbaine), des organisations commerciales et des syndicats pour veiller à ce que l’attention des É.-U. se porte sur les intérêts bilatéraux.
En fait, l’ACEUM pourrait même se révéler positif. Les règles d’origine les plus contraignantes sur lesquelles les É.-U. insistaient n’avaient pas pour objectif de laisser le Canada et le Mexique sur la touche, soulignait le représentant commercial des É.-U., Robert Lighthizer, dans un récent article paru dans Foreign Affairs, mais de contrecarrer les resquilleurs. « Elles [les nouvelles règles de l’ACEUM] feront en sorte que les avantages de l’accord profiteront avant tout au Canada, au Mexique et aux États-Unis, mais pas aux pays qui n’ont pas offerts un accès réciproque aux marchés. »
Alors que la pandémie provoque un ré-alignement commercial régional axé sur les chaînes d’approvisionnement, le Canada pourrait devenir un joueur clé de la « relocalisation » et ainsi travailler avec les États-Unis dans le cadre d’initiatives communes, notamment dans des secteurs sensibles comme l’équipement médical, l’Internet et la cybersécurité.
L’ACEUM comprend encore beaucoup de volets non réglés. Selon une évaluation tirée de l’étude de Statscan, dont nous avons parlé auparavant, les barrières non tarifaires permanentes à la frontière canado-américaine, soit les divergences dans les règlements, les formalités administratives, les retards de livraison liés aux douanes et l’incertitude politique, équivalent en bout de ligne à un tarif de 30 %. Ces obstacles constituent une entrave considérable au commerce continental.
Le Canada travaille à ce programme de réglementation et de facilitation du commerce sous le radar depuis des années, avec des résultats mitigés. Il doit continuer à chercher des opportunités dans des secteurs qui intéressent fortement ses interlocuteurs américains. Ce programme met à profit ce qui reste d’une remarquable architecture de liens bilatéraux nationaux, sous-nationaux, sectoriels, régionaux, qui joue encore un rôle prépondérant pour atténuer l’effet des récents excès rhétoriques. Ces connexions institutionnelles, le genre de chose que le président Trump a désigné dans d’autres contextes comme l’« État profond », ont vu le jour en 1909 avec la Commission mixte internationale avant de se répandre comme des toiles d’araignée au fil des décennies.
Elles touchent aussi le domaine de la défense. À l’approche d’un examen prescrit du NORAD, le Canada a l’occasion de mettre en lumière ses liens militaires. Comme un autre fonctionnaire canadien le disait récemment, la défense et la sécurité peuvent constituer le fondement solide et silencieux d’une relation bilatérale. L’Arctique, qui suscite un intérêt croissant de la part des É.‑U. du fait que le « Grand jeu » du 21e siècle fait intervenir la participation de la Russie et de la Chine, pourrait constituer une occasion similaire.
La relation bilatérale nécessite aussi une présence non militaire plus vaste sur le terrain. Durant la re-négociation de l’ALÉNA, la campagne canadienne de lobbying était connue de façon informelle sous le nom de « stratégie du beignet », la Maison-Blanche et les insultes de Trump étant le trou et les 50 États au-delà de la Beltway le gâteau. Bien qu’elle ait fonctionné, elle a aussi souligné le fait que le corps diplomatique du Canada manque de ressources aux É.-U.
Après les attaques terroristes de 2001, Ottawa a lancé une « initiative de représentation accrue » pour fortifier sa relation avec les É.-U. face aux craintes liées à un renforcement de la frontière. Mais quelques années plus tard déjà, les ressources supplémentaires consenties se sont taries.
La représentation canadienne ne doit pas être fortement différente de celle d’un pays comme le Mexique, qui a environ trois fois plus de consulats que le Canada aux É.-U.; la multitude de Mexicains présents aux É.-U. entraîne un accroissement des défis consulaires. Le Canada est le seul pays qui a le privilège d’avoir son ambassade entre le Capitol et la Maison Blanche. Sa présence hors de Washington doit être tout aussi remarquable.
Le nombre de pays qui prétendent avoir une relation spéciale avec les États-Unis élargit considérablement la signification du terme « spécial ». Les Philippines, de même que la France et l’Australie, font partie du lot. Cette expression est le plus souvent associée à l’étroite relation que les États-Unis entretiennent avec la Grande‑Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le Canada a une bonne raison de revendiquer une relation spéciale avec Washington, bien que Richard Nixon, encore lui, ait montré qu’il n’avait aucunement l’intention de nourrir un tel concept lors d’une visite à Ottawa en 1972 : « il est grand temps que nous reconnaissions que nous avons des identités très distinctes; que des différences substantielles nous séparent… »
Aujourd’hui, vu les événements des dernières années, l’idée même que le Canada, ou n’importe quel autre pays, entretienne une relation spéciale avec Washington relève de l’utopie, ou de la naïveté.
Les perspectives mondiales pour les États-Unis changeront lors des élections, mais il semblerait que, dans une certaine mesure, la philosophie de l’« America First » soit là pour durer. À l’approche des élections, la meilleure approche internationale que le Canada puisse adopter pourrait être de se tourner vers d’autres marchés, d’autres amis et, peut-être, vers d’autres initiatives visant à aider les États-Unis à renouer avec les autres pays.
Autres marchés : il y a une dizaine d’années, le Canada était en retard par rapport à la majorité des pays industrialisés en termes de relations de libre-échange. Il avait alors l’ALÉNA, bien sûr, ainsi que des accords avec Israël, le Chili et le Costa Rica. Son accord avec Singapour est toutefois demeuré dans l’ombre, car Ottawa insistait pour jouir de la même faveur que Washington.
Les efforts des gouvernements Harper et Trudeau ont transformé les liens commerciaux du Canada lors de la signature du pacte entre le Canada et l’Union européenne et de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre le Canada et 10 autres pays de l’Asie-Pacifique (dont Singapour, mais pas les États-Unis).
L’ACEUM a emprunté le langage technique du PTPGP, mais il y a peu de chance que l’administration Biden cherche à raviver l’adhésion des É.-U. L’hostilité vis‑à‑vis du libre‑échange est d’autant plus forte que Washington est actuellement confrontée à un problème de consensus; sans parler de son antipathie grandissante envers la Chine. Même le libre-échange avec l’Europe, qui a été proposé pour la première fois par Washington et Bruxelles il y a 25 ans, est devenu un vieux pieu.
À l’intérieur du pays, le secteur privé doit être à même de saisir et d’exploiter l’occasion. Le Service des délégués commerciaux du Canada et Exportation et développement Canada ont consenti beaucoup d’efforts pour créer des outils de promotion du commerce et de l’investissement. Mais les données statistiques des dernières années sur le commerce du Canada avec l’Europe et l’Asie sont partagées et le fait que la pandémie encourage le régionalisme au détriment de la mondialisation peut se révéler problématique. Il n’en reste pas moins que le Canada doit garder son regard sur le commerce extérieur.
Autres amis : L’approche unilatéraliste que Trump a adoptée lors de son premier mandat demeurerait probablement durant son second mandat. Et elle forcerait le Canada à bien réfléchir pour déterminer qui sont ses véritables amis, surtout à une époque où ses relations avec les quatre grandes puissances du monde semblent avoir atteint un creux historique : il n’y a pas juste les États‑Unis avec leur intention de retranchement, mais aussi la Russie, revancharde, l’Inde, belliqueuse, et la Chine avec ses velléités autoritaires.
Tant le gouvernement libéral que l’opposition conservatrice ont parlé positivement des étapes menant à l’édification d’une coalition de partisans aux vues similaires du système mondial contesté; il ne s’agit pas simplement d’adeptes du multilatéralisme en tant que tel, mais de pays qui favorisent spécifiquement la démocratie, les droits de la personne et les sociétés ouvertes.
L’Alliance pour le multilatéralisme a vu le jour il y a 18 mois à partir d’une initiative lancée par l’Allemagne, la France, le Japon et le Canada. La crise de la COVID a ouvert la voie à une telle alliance, vu la nécessité d’une collaboration entre les pays, y compris en ce qui concerne le rôle critique des organismes mondiaux voués à la santé comme l’Organisation mondiale de la santé. En effet, 24 pays aux vues similaires ont signé une déclaration conjointe le printemps dernier, comparant la crise à un « appel au multilatéralisme ».
Grâce à cette coalition croissante, il sera possible d’accomplir plus. Elle pourrait encourager les investissements et l’intégrité des élections face à la montée du protectionnisme et du populisme, l’immigration face à la fermeture des frontières et la mise en exergue de la menace du changement climatique, qui, en raison de la pandémie, a reculé au rang des préoccupations du public. Le Canada a dirigé des efforts assez similaires concernant l’Organisation mondiale de la santé. Cela ne suffit pas pour endiguer le flot de l’antilibéralisme, mais ça aide.
Autres efforts des É.-U. : la sensibilité américaine semble être devenue un concept bien ancré maintenant qu’on a constaté que le leadership américain s’accompagne d’un prix trop élevé pour le type d’avantage qu’il procure, comme si seulement Washington dirigeait et que personne d’autre ne partageait son fardeau.
Mais la présidence de Biden permettrait de défaire au moins certains des excès de Trump, notamment en ce qui concerne l’engagement des É.-U. envers la lutte contre le réchauffement planétaire. Le commerce international est peut-être devenu un troisième rail, à l’exception de l’ACEUM, mais il convient de ne pas remettre l’accent sur le contrôle des armements, ni sur les responsabilités collectives de l’OTAN. La coordination de la pandémie à l’échelle mondiale, y compris une position responsable concernant l’OMS, serait l’un des premiers fruits d’une victoire de Biden.
Au fil des décennies, on a fini par considérer l’engagement multilatéral du Canada comme un moyen de limiter l’influence des É.-U. sur le Canada. Mais ce n’est pas ainsi que les choses ont commencé. Après l’entrée des É.-U dans la Seconde Guerre mondiale, le Canada craignait que les É.-U. rentrent chez eux une fois la victoire acquise. L’isolationnisme des É.-U. a alors constitué un pilier de la politique américaine durant une génération, à commencer par la décision de ne pas se joindre à la Ligue des Nations, et jusqu’à Pearl Harbor.
L’intérêt national du Canada était lié à la sécurité collective, réalisable uniquement grâce au leadership actif des É.-U. Telles furent les premières années de la diplomatie canadienne. Le Canada à aidé Washington à créer les institutions de l’après-guerre : les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’OTAN, qui semblent maintenant menacées du fait que les États-Unis remettent à nouveau en question leur rôle sur le plan mondial.
Bien sûr, la situation actuelle est différente de celle d’alors. Mais la vocation multilatérale du Canada pourrait à nouveau être déployée pour encourager les États‑Unis, suite à l’élection et en fonction de l’issue du scrutin, à devenir un leader responsable dans un monde plus complexe et plus dangereux.
« L’établissement de notre propre perspective internationale et notre relation bilatérale tentaculaire avec les É.-U. ne sont que deux dimensions d’une seule et même préoccupation qui domine notre existence depuis un demi-siècle », déclarait Allan Gotlieb en 1991, peu de temps après le terme de son affectation de huit ans à titre d’ambassadeur du Canada à Washington. « Notre principale préoccupation nationale a été de faire en sorte de limiter l’emprise des É.-U. sur le destin de notre nation tout en tirant le maximum de profit de notre proximité. »
Selon M. Gotlieb, nous vivions alors à une ère de discontinuité avec la fin de la guerre froide. Nous étions peut-être à un autre tournant, non pas à la supposée « fin de l’histoire » de 1991, mais au retour manifeste de la jungle. Dans des circonstances aussi complexes, le Canada ne peut que s’efforcer de protéger au mieux ses intérêts, mais il doit faire tout son possible, surtout au Sud de la frontière.
- Selon la Banque mondiale, les exportations et les importations canadiennes de biens et de services représentaient environ 65 % du PIB en 2019, alors qu’elles s’élevaient à environ 50 % en 1989, lorsque le libre‑échange est entré en vigueur. Ce chiffre a atteint un sommet de 83 % en 2000 après des décennies de croissance à deux chiffres des échanges commerciaux entre le Canada et les É.-U. En 2019, le pourcentage correspondant s’élevait à 27,5 pour les États-Unis. Environ 18 % des exportations américaines ont été vendues au Canada en 2019. ↑
- Les scientifiques politiques américains Norm Ornstein et Thomas Mann désignent ce phénomène sous le terme de « polarisation asymétrique », c’est‑à‑dire que, bien que le parti démocrate se soit incliné vers la gauche, le parti républicain a accentué sa tendances vers la droite. ↑
- Exemple marquant de ce changement, le Groupe des Sept pays industrialisés a été proposé sous la présidence de Nixon, lors de la crise du pétrole de 1973, bien que le nombre de ses membres soit passé à sept en 1976 seulement, lorsque le Canada a fait son entrée cette année là, en grande partie à la demande des États-Unis. D’aucuns ont critiqué le G7, qui serait devenu démodé en raison de la montée de la Chine et d’autres joueurs mondiaux d’envergure. Il n’en reste pas moins que ce Groupe offre aux principaux pays démocratiques une importante possibilité stratégique de coordonner leurs actions et a constitué une source majeure de prestige et d’influence pour le Canada. Le sommet de 2020 était prévu en juin, mais il a été remis par le pays hôte, les É.-U. Il est maintenant peu probable qu’il ait lieu cette année. ↑
- La comparaison la plus pertinente n’est peut-être pas l’élection de 2000, mais celle de 1876. Cette année là, un vote serré et l’absence d’un gagnant clair au collège électoral a obligé un Congrès divisé, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, à prendre une décision. Le résultat électoral a enclenché une entente politique. Le républicain Rutherford B. Hayes est entré en fonction, et le démocrate Samuel Tilden a admis cette décision, mais, en contrepartie, les Républicains ont retiré les troupes fédérales du Sud des États‑Unis, où elles étaient stationnées depuis la fin de la guerre civile. Cet événement a marqué le début des lois de Jim Crow, de la ségrégation et des autres formes de discrimination, dont les restrictions de vote, qui ont assujetti les Afro-Américains tout au long de l’avènement du mouvement des droits civils modernes. ↑
- Pour en savoir davantage à cet égard : https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/jon-johnson-%E2%80%93-buy-american-and-economic-relations-canada ↑
- Rédigé par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Mitchell Sharp, ce document est paru dans International Perspectives, qui était alors un journal du ministère des Affaires extérieures. ↑
- Selon la Banque mondiale, le PIB du Canada a crû plus rapidement que celui des É.-U. 16 fois au cours des 30 dernières années (entre 1990 et 2019). Cependant, durant la même période, l’économie américaine est passée de 5,963 à 21,374 billions de dollars, ce qui représente une augmentation de 258 %. Pour sa part, le Canada, qui est passé de 593,93 milliards de dollars 1,736 billion de dollars a enregistré une croissance de 192 %. Voir : https://data.worldbank.org/country/united-states et https://data.worldbank.org/country/canada ↑
- Ces chiffres sont tirés d’un document, qui sera publié prochainement, sur les perspectives de croissance de l’Ontario et la stratégie d’Ontario360, une initiative de politique publique hébergée à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto. ↑
- Dans son article, le FMI relève qu’au début des années 1980, le commerce interprovincial et le commerce international étaient à peu près égaux. Aujourd’hui, le commerce international représente environ 65 % du PIB, tandis que le commerce interprovincial représente environ 40 %. (Le commerce interprovincial de services est toutefois supérieur au commerce international de services) https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/22/Internal-Trade-in-Canada-Case-for-Liberalization-47100 ↑
- See https://ppforum.ca/publications/fix-the-grid-clean-electricity/ ↑
PARTENAIRES
Partenaires du secteur privé : Manuvie et Shopify
Partenaire de consultation : Deloitte
Gouvernement : Gouvernement du Canada
Gouvernements provinciaux :
British Columbia, Saskatchewan, Ontario et Québec
Partenaires de recherche : Conseil national de recherches Canada et Centre des Compétences futures
Fondations: Metcalf Foundation
FPP tient à reconnaître que les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux des partenaires du projet.