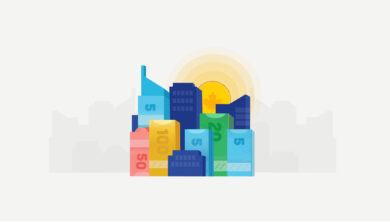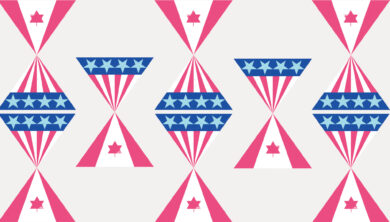Remettre le local au cœur des médias locaux
Introduction
On fait difficilement plus local que Haida Gwaii, archipel isolé au large de la côte du nord de la Colombie-Britannique, qui compte moins de 5 000 habitants répartis entre sept villages. Lorsque le journal qui couvre l’actualité de l’archipel a été vidé de sa substance par son propriétaire, Black Press, ce sont bien plus que des nouvelles qui ont disparu.
Peu de candidats se sont présentés aux élections municipales; l’ensemble du conseil de l’un des villages a été élu par acclamation; un rapport important sur les risques d’un éventuel tsunami n’a pas été publié.
De plus, certains programmes sportifs n’ont pas été mis en œuvre parce que personne n’en avait eu connaissance. Dans une région où le service Internet est déficient, voire inexistant, il n’y avait tout simplement plus aucun moyen d’informer la population de ce qui se passait.
Entre alors en scène Stacey Brzostowski, une ex-journaliste devenue administratrice d’un cabinet vétérinaire. À l’été 2024, elle lance une nouvelle publication bihebdomadaire, les Haida Gwaii News, qu’elle produit sur sa table de cuisine. Elle en imprime 1 500 exemplaires et les distribue elle-même dans tout l’archipel en voiture et en traversier.[1] « Un énorme fossé s’est creusé entre la population et la municipalité, résume-t-elle au FPP. Il faut le combler. »
La survie des Haida Gwaii News est loin d’être assurée. Cette entreprise qui emploie deux personnes est tributaire de la publicité locale, des donateurs de Patreon et des habitants qui glissent un chèque dans la main de Mme Brzostowski quand elles la croisent dans la rue. Comme cette entreprise en démarrage est encore dans sa première année, elle n’a même pas droit à une aide gouvernementale pour l’instant. Mais son existence surprenante, née de la conviction profonde qu’une communauté a besoin d’être informée, est au moins un signe d’espoir dans le paysage bien sombre des nouvelles locales.
Dans l’ensemble, la situation des organes de presse locaux au Canada est désastreuse : de nombreux propriétaires n’arrivent tout simplement pas à s’en sortir. Depuis 2008[2], plus de 340 collectivités ont perdu leur fournisseur de nouvelles locales, et la tendance se poursuit. Les coupes budgétaires, les fermetures et l’affaiblissement général ont atteint un point tel que, dans certaines localités, on ne trouve plus qu’un « journal fantôme » : son titre est familier, mais il ne contient pas de nouvelles locales, ou alors très peu. Chaque année, de plus en plus d’organes de presse sont victimes de l’effondrement des modèles économiques des médias traditionnels.
Le présent rapport est le fruit d’une conférence inaccoutumée organisée par la Fondation des prix Michener et la Fondation Rideau Hall. Tenue à Charlottetown (Î.-P.-É.) fin 2024, elle a rassemblé plus de 60 éditeurs et diffuseurs de nouvelles locales de tout le pays qui y ont fait part de leurs difficultés, ont échangé des idées sur l’innovation et ont suggéré des mesures à adopter pour sauver les médias locaux.
Ce rapport s’intéresse aux réponses viables. Notre principe de base est que les médias locaux doivent être véritablement locaux, c’est-à-dire qu’ils doivent être produits par des membres de la collectivité pour d’autres membres de la collectivité. Lorsque les organismes médiatiques sont détenus et gérés par des personnes proches des lecteurs et des annonceurs dont ils dépendent, cela fait une énorme différence. Il est trop facile pour les propriétaires d’entreprises éloignées de vider de leur substance les médias locaux, ceux-ci n’étant pour eux que des postes de bilan.
Nous nous appuyons sur une douzaine d’entretiens, ainsi que sur un questionnaire détaillé concernant le secteur, les résultats d’un sondage exclusif, des études de cas et de nouvelles données pour examiner la situation des médias véritablement ancrés dans leur communauté, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et la manière dont l’innovation et les politiques publiques peuvent leur permettre de demeurer forts.
Les médias locaux revêtent une importance névralgique pour les collectivités, dont ils resserrent les liens entre les membres. Ils s’adressent aux gens là où ils vivent, littéralement. Ils créent des relations à travers des nouvelles éphémères telles que les annonces de mariage, les nécrologies et les résultats des matchs des petites ligues, tout en rendant compte des fondements mêmes d’une démocratie saine et fonctionnelle : les réunions du conseil des écoles, les procès devant les tribunaux, les conseils municipaux. Si l’information locale est de bonne qualité, elle permet aux gens de savoir ce que font leurs voisins, ce qu’ils pensent, qui ils sont. Elle offre aux membres d’une communauté la langue dans laquelle se comprendre.
En l’absence de ce lien, la communauté se délite et se polarise, la confiance s’effrite et les résidents se déconnectent des institutions locales. Des données fiables provenant des États-Unis, où ces tendances sont suivies de près depuis longtemps, montrent que les résidents des collectivités qui ont perdu leur journal ont tendance à tomber dans la partisanerie.[3],[4],[5] Le vide créé par l’absence de nouvelles locales fiables est comblé par les nouvelles nationales, qui sont généralement plus clivantes, ainsi que par les médias sociaux, où la vérité et le mensonge se font concurrence sur un pied d’égalité.[6] L’absence de médias locaux signifie également que les autorités locales, la police, les écoles et d’autres institutions vitales sont moins surveillées, ce qui nuit souvent à leur efficacité. Les médias locaux incitent ces autorités à rendre des comptes aux personnes qu’elles servent. Lorsque personne ne regarde, la confiance dans la communauté diminue.
77 % : Il est important de disposer d’une source d’information locale
87 % : Les médias locaux sont importants pour le bon fonctionnement de la démocratie
Source : Sondage en ligne Ipsos (janvier 2025). Environ la moitié des 1 001 répondants (résidents canadiens âgés de 18 ans et plus) vivaient dans des collectivités de moins de 10 000 habitants, tandis que l’autre moitié vivaient dans des collectivités de 10 000 à 100 000 habitants.
Une chose est sûre : les modèles d’entreprise existants ont été dévastateurs pour l’information locale au Canada. Depuis de nombreuses années, les grands propriétaires de médias, tant dans la presse écrite que dans la radiodiffusion, ferment des organes médiatiques et en vident d’autres. Les médias indépendants sont également en train de disparaître, mais étant davantage concernés par leur milieu, ils ont tendance à se battre avec plus d’acharnement.
Renforcer l’information locale et favoriser la propriété locale doivent aller de pair. La restauration d’un écosystème florissant de médias locaux ne peut se faire sans un renforcement des liens qui unissent les organes de presse locaux aux communautés qu’ils desservent.
Il faut donc remettre le local au cœur des médias locaux.
Voici comment faire.
CHAPITRE UN – De puissants vents contraires
April Lindgren, professeure à l’école de journalisme de l’Université métropolitaine de Toronto (TMU), recense les médias locaux dans tout le pays depuis 2008. À titre de chercheuse principale du projet de recherche sur les médias locaux de la TMU (Local News Research Project)[7], elle observe le déclin constant de ces médias, et ses données les plus récentes révèlent des faits plus inquiétants que jamais.
La pandémie a apporté un certain soulagement, car les organes de presse locaux, comme d’autres entreprises, ont bénéficié de subventions gouvernementales. Mais en 2023, les coupes et les fermetures ont repris : 37 médias locaux ont fermé leurs portes (29 journaux et huit stations de radio). Seuls neuf nouveaux médias ont été lancés. Au cours des 11 premiers mois de 2024, cinq autres entreprises ont fermé leurs portes, mais neuf nouvelles entreprises ont vu le jour.[8]
Cela porte à 526 le nombre d’organes de presse locaux qui ont cessé leurs activités dans 347 collectivités canadiennes depuis 2008. La grande majorité d’entre eux étaient des journaux. Au cours de la même période, 402 nouveaux organes médiatiques ont ouvert leurs portes, mais seuls 274 d’entre eux ont survécu.
Selon Mme Lindgren, les petites collectivités ont été particulièrement touchées. Près de la moitié des fermetures survenues depuis 2008 ont concerné des localités de moins de 20 000 habitants. « Les petites communautés sont plus vulnérables, explique la chercheuse. Il y a moins d’endroits où se renseigner sur ce qui s’y passe. »
Dans le cadre d’un sondage exclusif[9] réalisé par Ipsos en janvier 2025 pour étayer ce rapport, un échantillon de 1 000 Canadiens vivant dans des collectivités de moins de 100 000 habitants ont été interrogés sur les médias locaux. Alors que 87 % des répondants ont déclaré que les médias locaux sont importants pour le bon fonctionnement de la démocratie, 28 % ont déclaré avoir moins de sources de nouvelles locales qu’il y a cinq ans. (Les résultats sont considérés comme représentatifs de la population canadienne adulte et exacts à plus ou moins 3,6 points de pourcentage.)
En outre, le sondage a clairement montré que les journaux locaux et la radio locale sont de loin les sources d’information les plus fiables : 86 % des répondants étaient de cet avis dans les deux cas, plus que pour les médias nationaux (70 %) ou internationaux (56 %).
L’importance des médias locaux pour les répondants rend d’autant plus inquiétante la tendance croissante à la « pauvreté de l’information » (les zones où il y a peu de médias locaux de qualité) dans de nombreuses communautés à travers le Canada, selon les observations de Mme Lindgren.
Dans le même temps, le lancement de nouveaux médias en ligne est devenu plus difficile en raison de la décision prise par Meta en 2023 de bannir les nouvelles canadiennes de Facebook et d’Instagram en réponse à la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18)[10]; celle-ci oblige les entreprises technologiques à rémunérer les médias pour l’utilisation de leur contenu. « Les jeunes entreprises en ont énormément pâti, explique Mme Lindgren. Comment se faire découvrir? »
Derrière les chiffres se cache un effondrement inexorable des recettes publicitaires qui ont longtemps été l’oxygène des organes de presse, même au niveau local. Selon des données fournies par Médias d’Info Canada, entre 2018 et 2022, les recettes publicitaires des journaux communautaires canadiens ont chuté de 44 %, passant de 688 à 385 millions de dollars. Les recettes publicitaires des stations de radio locales ont chuté de 33 % au cours de la même période, passant de 1,51 à 1,10 milliard de dollars. La grande majorité de ces dollars sont allés aux géants du numérique étrangers, en particulier Google et Meta.
Les fermetures et les compressions budgétaires ont été particulièrement dévastatrices en 2023. En janvier, Postmedia a annoncé qu’elle licenciait 11 % de son personnel éditorial et qu’elle convertissait une douzaine de journaux communautaires en journaux uniquement numériques.[11] Ces licenciements s’ajoutaient aux coupes sombres opérées depuis des années dans les rédactions de ses plus grandes propriétés.
Des titres célèbres comme la Gazette de Montréal, le Ottawa Citizen et le Vancouver Sun, qui s’enorgueillissaient d’avoir des rédactions de plus de 100 personnes il y a une douzaine d’années à peine, sont aujourd’hui des coquilles vidées de leur substance avec des rédactions de 25 personnes au plus, qui peinent à couvrir les principales zones métropolitaines. Les journaux Sun, qui étaient autrefois des concurrents acharnés des titres à grand tirage établis dans la plupart des grandes villes à l’ouest du Québec, ont été fusionnés en un seul journal très affaibli dans chaque ville. La centralisation du système d’édition de Postmedia – qui fait en sorte que les pages communes de nouvelles nationales, internationales et commerciales sont produites en un seul endroit pour tous les marchés – a fait perdre aux journaux locaux de nombreuses décisions éditoriales.
En septembre 2023, la filiale Metroland de Torstar s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites et a annoncé 605 licenciements, soit les deux tiers de ses effectifs.[12] Elle a mis fin aux activités imprimées de 71 publications communautaires, les convertissant au numérique uniquement et réduisant leur capacité à couvrir l’actualité locale. La tendance s’est poursuivie en 2024 : en août, Postmedia a acquis SaltWire Network Ltd, la plus grande chaîne de journaux du Canada atlantique, et a immédiatement annoncé un nombre indéterminé de licenciements dans les rédactions.[13],[14]
Les conséquences ont été tout aussi dévastatrices pour les entreprises de radiodiffusion. Corus Entertainment a supprimé 300 emplois en 2024 et fermé des stations de radio locales à Vancouver et à Edmonton.[15] Bell Média a mis en vente neuf stations locales en 2023 et 45 autres au début de 2024, tout en réduisant les émissions d’information en semaine dans les stations BNN Bloomberg et CTV à travers le pays.[16] « Ce n’est plus une activité viable », a déclaré l’entreprise.
Certaines de ces fermetures ont eu des effets particulièrement graves. En juin 2023, Jessica Wallace, de Kamloops This Week, en Colombie-Britannique, avait été retenue parmi les finalistes du prix Michener, le plus grand prix de journalisme du Canada, pour des articles qui ont révélé des dépenses suspectes dans le district régional de Thompson-Nicola, notamment des soirées dans des restaurants et des salles de dégustation de champagne ainsi qu’un versement de 500 000 dollars pour la retraite d’un directeur général. Le jury avait vu dans le travail du journal bihebdomadaire « un exemple exceptionnel de ce qui constitue la base du journalisme ». Quelques mois plus tard, son propriétaire fermait le titre : pour la première fois depuis 1884, la collectivité de 100 000 habitants s’est retrouvée sans journal.
« C’était un peu comme si nous étions aux premières loges de nos funérailles, a dit Mme Wallace au National Post, parce que nous étions contactés par toutes sortes de gens dans la communauté qui portaient le deuil avec nous. »[17]
Mais le pire était déjà en train de se produire en ligne.
En août 2023, Meta a bloqué l’accès des Canadiens aux nouvelles sur Facebook et Instagram, conséquence de l’opposition de l’entreprise à la Loi sur les nouvelles en ligne. Après un an d’interdiction, une étude de l’Observatoire de l’écosystème des médias (MEO) a révélé que les interactions avec le lectorat sur Facebook avaient diminué de 64 % pour les organes de presse nationaux et de 85 % pour les organes de presse locaux.[18]
« Dans une société attachée à la vérité et soucieuse d’avoir une population informée pour garantir une meilleure santé démocratique et réclamer des comptes aux politiciens, c’est une très mauvaise nouvelle, a commenté Aengus Bridgman, directeur du MEO. Les organes de presse canadiens ont perdu une part énorme de leur auditoire en ligne. »[19]
L’étude du MEO a également révélé que les autres plateformes de réseautage social n’ont pas compensé ces pertes, ce qui s’est traduit par une baisse globale de 43 % des interactions en ligne. Theresa Blackburn, éditrice et rédactrice en chef du River Valley Sun – qui a pour slogan « Possédé, géré et imprimé au Nouveau-Brunswick! » – a assisté en temps réel à la chute vertigineuse de ses interactions en ligne.
Pendant des années, la seule présence numérique de son journal mensuel gratuit, qui dessert la vallée du Haut-Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, était sur Facebook. « Nous avons utilisé Facebook parce que c’était gratuit, déclare-t-elle dans une entrevue à Steve Paikin de The Agenda en septembre 2024. Ça a été notre seule présence en ligne pendant un certain nombre d’années. »[20]
Puis vint l’interdiction des nouvelles.
« Nous avons perdu non seulement la capacité de diffuser des informations, mais aussi celle de mobiliser notre public, constate Mme Blackburn. Nous avons perdu notre canal de diffusion rapide des informations. […] Lorsqu’une personne est en train de regarder des photos de ses petits-enfants [sur Facebook] et qu’elle voit apparaître notre message indiquant qu’il y a un avis d’ébullition d’eau dans la ville, elle le voit très rapidement. [Sans cet accès,] il y a un problème. »
De plus, les archives Facebook du River Valley Sun ne sont plus accessibles au Canada. Mme Blackburn, qui habite non loin de Houlton (Maine), doit traverser la frontière américaine pour accéder à ses propres archives.
« Facebook nous a tellement pris, ils ne peuvent pas être un acteur de la communauté, dit-elle. Ils sont prêts à prendre tout l’argent, mais ils ne veulent pas nous aider à informer le public. Nous avons un journal ici depuis 1848. Et ce journal ne mourra pas sous ma gouverne. Mais la pression est énorme. »
CHAPITRE DEUX – Les jeunes pousses
Les journaux locaux sont les gardiens de la mémoire collective des communautés. Personne d’autre n’enregistre l’histoire des collectivités semaine après semaine, en mots et en images. Lisa Sygutek, propriétaire et éditrice de l’hebdomadaire Crowsnest Pass Herald, dans le sud-ouest de l’Alberta, se rappelle cette vérité motivante chaque fois qu’elle pénètre dans ses bureaux.
L’agrandissement d’une photo tirée des archives du journal trône au-dessus de ses fenêtres : il montre le défilé d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale de la ville accueillis par des vétérans de la Première Guerre mondiale. C’est une image frappante. « Les journaux locaux, dit Mme Sygutek, sont le journal de bord de leur communauté. »
Cette photographie n’existerait pas sans la présence du Pass Herald, comme on l’appelle, une entreprise familiale créée en 1930. Depuis 2014, le journal a perdu les deux tiers de ses revenus et son effectif est passé de huit à quatre personnes, ce qui n’empêche pas Mme Sygutek d’estimer que la publication n’a jamais été aussi pertinente. Située dans une région minière, Crowsnest Pass est au cœur d’une controverse à propos d’un projet de nouvelle mine de charbon aux environs. « C’est une question litigieuse, dit Mme Sygutek. Nous avons reçu de nombreuses lettres des deux bords. »
La controverse place Crowsnest Pass au cœur des débats provinciaux, nationaux et internationaux concernant l’urgence d’une transition énergétique – tout en replaçant cette urgence dans un contexte, ce que font les meilleurs organes de presse locaux.
Le paysage n’est pas entièrement sombre. Certains médias locaux continuent de bien servir leur collectivité en utilisant un modèle économique traditionnel : celui de journaux imprimés avec détermination qui desservent le lectorat de régions au service Internet déficient et soutenus principalement par la publicité locale.
Des journaux comme le Crowsnest Pass Herald, le Wellington Advertiser dans le sud-ouest de l’Ontario et le Prince Albert Daily Herald en Saskatchewan sont gérés par des exploitants indépendants ancrés dans leur communauté. Ils parviennent à dégager des bénéfices, qui n’ont cependant rien à voir avec les marges exigées par les fonds spéculatifs. Les problèmes de ces journaux locaux prospères sont souvent assez classiques; c’est par exemple le mauvais service de Postes Canada, dont ils dépendent pour la distribution.
La plupart des nouvelles entreprises, en revanche, sont numériques. Des jeunes pousses dynamiques comme Cabin Radio[21], à Yellowknife (T.N.-O.), trouvent des moyens novateurs de servir leur communauté. À Toronto, The Local[22] a adopté un modèle philanthropique dès le départ et assure une couverture locale importante dans les quartiers mal desservis de la plus grande ville du pays. À Kamloops, où le journal de Jessica Wallace a été récompensé par un prix Michener, plusieurs petites entreprises en ligne, dont The Wren[23], ont vu le jour pour offrir une couverture de base de l’actualité locale. En octobre 2024, un groupe local de bénévoles a lancé un nouveau mensuel imprimé, le Kamloops Chronicle (« Votre voix, votre communauté »).[24] Un nouvel écosystème florissant de jeunes pousses a été identifié dans le sondage Ipsos de janvier 2025 : 20 % des Canadiens vivant dans une petite collectivité ont déclaré qu’ils y trouvaient davantage de sources d’information locales qu’il y a cinq ans.[25]
Village Media, par exemple, qui a vu le jour il y a deux décennies à Sault Ste. Marie (Ontario), possède aujourd’hui plus d’une vingtaine de sites Web dans tout l’Ontario et se targue de sa « mission de sauver les médias locaux », notamment dans les collectivités abandonnées par les entreprises médiatiques traditionnelles. En octobre 2024, elle a lancé dans des communautés ontariennes une nouvelle plateforme de média social, SPACES, dans le but de faire « un peu de concurrence » aux grandes plateformes comme Facebook et Reddit.[26]
De nouveaux organismes apparaissent même pour soutenir d’autres organes de presse qui se créent : en 2020, Indigraf, une plateforme canadienne de publication tout-en-un, a été lancée pour « soutenir la prochaine vague de journalistes entrepreneurs » en fournissant des outils aux journaux en démarrage.
D’autres médias, en particulier au Québec, utilisent des modèles sans but lucratif. De grands titres comme La Presse et Le Devoir sont devenus des organisations journalistiques enregistrées (OJE)[27], ce qui les exonère de l’impôt sur le revenu et leur permet de délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs. Lorsque les propriétaires de six petits quotidiens francophones – dont ceux de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Ottawa – ont menacé de les fermer, ceux-ci ont formé en 2019 la Coopérative nationale de l’information indépendante, un organisme sans but lucratif. Ils ont également acquis le statut d’OJE.
Au Québec, le modèle philanthropique est largement utilisé : on lui attribue le mérite d’avoir permis à de nombreux journaux parmi les plus importants de la province de s’établir durablement. Au Canada anglais en revanche, ce modèle est peu utilisé. Le gouvernement fédéral a créé le modèle médiatique OJE en 2019; or, seuls 12 organismes ont vu le jour dans l’ensemble du pays depuis lors. Sept se trouvent au Québec, ce qui en laisse seulement cinq (dont The Local, à Toronto, et The Narwhal, un magazine en ligne qui couvre des questions environnementales) dans le reste du Canada. Les organes médiatiques du Canada anglais, en particulier ceux qui se consacrent à la couverture locale, pourraient tirer un meilleur parti de ce modèle.
Nous reviendrons sur le potentiel de l’engagement philanthropique, mais il est utile de noter ici qu’un modèle caritatif relativement nouveau pour le journalisme est en train de s’implanter aux États-Unis. Report for America est un programme national sans but lucratif qui contribue au financement de journalistes dans des rédactions locales pour couvrir des communautés et des problèmes peu médiatisés.[28] Son modèle de financement est unique : 50 % du salaire d’un journaliste est payé par Report for America en utilisant un financement philanthropique non partisan; 25 % sont couverts par la rédaction elle-même; et les 25 % restants proviennent de dons de donateurs locaux, recueillis avec l’aide de Report for America. Grâce à ce programme, les rédactions apprennent en quelque sorte à « pêcher par eux-mêmes » en développant leurs capacités de collecte de fonds et leurs relations. Depuis 2017, le programme a fait entrer plus de 650 journalistes dans des salles de rédaction, grâce à la collecte de millions de dollars.
Au Canada, l’annonce faite en juin 2024 par Google de la création d’un fonds de 100 millions de dollars par an pour les médias canadiens, exemptant l’entreprise de la Loi sur les nouvelles en ligne, [29]a constitué un développement récent important. L’argent de Google, transféré au début de 2025, est distribué à des médias de tout le pays par l’intermédiaire du Collectif canadien de journalisme[30].
En janvier 2025, CBC/Radio-Canada a fait le point sur son projet d’utiliser sa part de 7 % du fonds Google (répartie entre les services français et anglais) pour embaucher 30 nouveaux journalistes locaux dans 22 communautés mal desservies, dont Fort St. John (C.-B.), Banff (Alberta), Steinbach (Manitoba) et le nord du Nouveau-Brunswick.[31] Alors que CBC News dispose actuellement de 48 bureaux et stations locales dans tout le pays, il y a « plus de 30 villes canadiennes de plus de 50 000 habitants dans lesquelles CBC n’est pas présente ».
Le sondage Ipsos a effectivement révélé un besoin : 29 % des répondants ont déclaré qu’ils apprécieraient une plus grande présence de la CBC dans leur communauté et 57 % ont déclaré qu’ils consommaient le travail de la CBC sur une plateforme ou une autre; il est clair cependant que l’expansion d’un radiodiffuseur national financé par les contribuables qui fait concurrence aux entrepreneurs dans les petites collectivités ne sera jamais qu’une solution partielle et problématique.
À Crowsnest Pass, Mme Sygutek estime que les gouvernements devraient consacrer une part de leur budget publicitaire aux médias locaux afin de permettre des débats essentiels au sein des collectivités. Mais elle a un autre cheval de bataille. Elle est la principale plaignante dans une action collective menée au Canada qui réclame 8 milliards de dollars à Google et Meta.[32] Selon les plaignants, ces entreprises se sont entendues pour manipuler la publicité en ligne et drainer les revenus de médias tels que le Pass Herald. Il faudra des années avant que l’action judiciaire aboutisse devant les tribunaux, mais celle-ci a ouvert une nouvelle voie dans la lutte contre les GAFAM, et d’autres plaignants suivent maintenant le mouvement : un cabinet d’avocats australien est en train de lancer une action similaire dans son pays. « C’est un phénomène mondial, commente Mme Sygutek. Le Canada n’est pas un cas isolé. »
Étude de cas no 1 – CHEK Media : d’employés à employeurs
Lancée en 1956 à Victoria, CHEK TV est la première télévision commerciale de la Colombie-Britannique. Lorsque Canwest Global Communications la met en vente en 2009 et qu’aucun acheteur ne se manifeste, la société annonce sa fermeture. C’est alors que les employés interviennent.
Grâce à un financement extérieur, au soutien de leur syndicat et à leurs propres économies, les employés de CHEK convainquent Canwest, alors au bord de la faillite, de leur céder la station pour la somme symbolique de 2 dollars. Quinze ans plus tard, le média est florissant.
En 2009, CHEK ne compte plus que 35 employés. La station en a aujourd’hui plus de 80 et s’est développée : elle produit une émission sportive quotidienne, des balados et du contenu Web, et elle a une présence vibrante sur les médias sociaux. Profondément ancrée dans la communauté, elle couvre l’actualité de la capitale de la Colombie-Britannique et de l’île de Vancouver. Le directeur général, Rob Germain, affirme que la station fait « plus de reportages locaux que jamais auparavant ». L’appartenance à une entreprise locale compte énormément pour attirer les annonceurs et les téléspectateurs locaux, explique-t-il. « Nos téléspectateurs restent nombreux et fidèles parce qu’ils savent que nous sommes là pour eux. »
Le modèle de l’actionnariat salarié se rencontre rarement au Canada : en fait, CHEK est la seule station de télévision d’Amérique du Nord à appartenir à ses salariés. Ceux-ci contrôlent quatre des sept sièges du conseil d’administration de la société, qui s’appelle désormais CHEK Media Group. Un comité paritaire (réunissant syndicat et employeur) supervise les opérations quotidiennes.
M. Germain a déjà vécu la réduction des effectifs qu’implique l’appartenance à une grande entreprise dont le siège se trouve dans une autre ville. Aujourd’hui, il se le promet : « Je ne veux plus jamais travailler pour une grande entreprise. » Pour CHEK, la clé du succès réside dans l’indépendance, l’appartenance à une entreprise locale et le fait d’être dirigée par les personnes qui y travaillent.
Étude de cas no 2 – The Eastern Door : renaissance d’une langue
The Eastern Door, un hebdomadaire publié depuis 1992 dans la communauté mohawk de Kahnawake, au sud de Montréal, s’est retrouvé au bord du gouffre pendant la pandémie. La publicité s’est tarie, mais Steve Bonspiel, rédacteur en chef et éditeur, l’affirme : « Nous ne voulions pas mourir. »
Dans ce petit journal dont le tirage est de 1 500 exemplaires pour une population de 6 500 personnes vivant dans la réserve, la crise a stimulé l’innovation. M. Bonspiel a lancé un produit très différent : un site Web destiné à préserver les récits des Aînés mohawks, rédigés à la fois en anglais et dans la langue autochtone kanien’keha. Il ne s’agit pas de « nouvelles » au sens classique du terme, mais d’informations d’un intérêt vital pour une communauté déterminée à faire revivre sa langue et à préserver sa mémoire collective.
L’hebdomadaire de 24 pages The Eastern Door tire 85 % de ses revenus de la publicité imprimée. Il emploie cinq personnes, dont M. Bonspiel, qui rédigent des reportages incisifs sur les affaires locales de Kahnawake. Un nouveau produit, Sharing Our Stories, a été lancé en 2022 et est devenu un organisme sans but lucratif l’année suivante, afin de pouvoir recevoir des subventions de la part de gouvernements ainsi que de fondations et d’organismes caritatifs. Un autre organisme sans but lucratif, The Pines Reporter, couvre l’actualité de la communauté mohawk de Kanesatake. Les deux OSBL reçoivent des fonds de l’Initiative de journalisme local, destinée à soutenir la création d’un « journalisme civique original », en particulier dans les communautés mal desservies.
Certains contenus de Sharing Our Stories sont publiés dans The Eastern Door, ce qui, selon Bonspiel, élargit le lectorat et fidélise celui du journal principal. Mais Sharing Our Stories a un objectif plus ambitieux : offrir aux Aînés mohawks un espace où raconter leur vie et le faire dans leur langue, s’ils le souhaitent.
Ce type de travail, ainsi que les reportages locaux qui figurent dans The Eastern Door, ne peuvent être réalisés que par des journalistes qui exercent au sein de la communauté dont ils parlent, explique M. Bonspiel. « Les gens nous croisent à l’épicerie ou à la banque. C’est pourquoi ils nous font confiance. »
Étude de cas no 3 – The Local : continuer sous forme d’OSBL
L’expression « déserts de l’information » désigne généralement de petites collectivités mal desservies par les médias traditionnels. Or, les grandes régions métropolitaines ont leurs propres déserts de l’information : des quartiers très peuplés, mais dont l’actualité locale est peu couverte.
The Local a été lancé en 2019 après que son fondateur a remarqué que certaines zones de la région du Grand Toronto n’étaient pas bien desservies par les médias traditionnels – par exemple, des quartiers comme Scarborough auxquels on ne prête pas attention ou qui sont mal compris. D’autres zones, comme la région de Peel (qui comprend Mississauga et Brampton), à l’ouest de Toronto, ont une couverture média sporadique malgré leurs centaines de milliers d’habitants. Tai Huynh, fondateur et éditeur de The Local, explique que son objectif n’était pas de concurrencer les médias traditionnels, mais de les compléter en consacrant des articles de fond à ces zones négligées : « Nous voulions un journalisme local qui ne se contente pas de survivre, mais qui soit excellent. »
Pour ce faire, M. Huynh et son équipe ont lancé un OSBL avec le soutien de cinq fondations qui se sont engagées à verser 125 000 dollars par an pendant trois ans. En 2022, The Local est devenu l’une des 12 organisations journalistiques enregistrées du Canada, ce qui permet au magazine de délivrer des reçus fiscaux et de solliciter des donateurs individuels.
The Local fait valoir auprès des bailleurs de fonds et des fondations philanthropiques que l’information locale est non seulement une question de journalisme, mais aussi une nécessité pour la santé politique et sociale de la collectivité. Ses cinq rédacteurs à temps plein et ses dizaines de pigistes ont publié des articles originaux sur l’impact de la pandémie dans les communautés défavorisées ainsi que sur les grandes disparités qui existent entre les quartiers de Toronto en matière de santé.
The Local s’intéresse également à la démocratie au niveau municipal. Selon M. Huynh, les médias traditionnels n’informent plus suffisamment l’électorat sur les affaires et les candidats locaux, ce qui se traduit par une baisse de la participation électorale et une augmentation du nombre de conseillers municipaux qui sont élus par acclamation. The Local assure une couverture détaillée des élections locales, comblant ainsi le vide laissé par les médias traditionnels, ceux-ci ayant réduit la couverture locale qui constituait autrefois une partie essentielle de leur mission.
Étude de cas no 4 – Cabin Radio : un centre d’échange d’information
Que fait un Anglais à la tête d’une station de radio dans les Territoires du Nord-Ouest? Ollie Williams, ancien journaliste sportif à la BBC, est parti dans le Nord pour rejoindre une petite amie rencontrée aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 et a fini par créer une station de radio d’information dynamique à Yellowknife.
Lancée en 2017, Cabin Radio diffuse un contenu audio en continu sur Internet 24 heures sur 24. La station emploie huit personnes, dont quatre journalistes, et est devenue une source essentielle de nouvelles locales dans une communauté où, selon M. Williams, la radio est encore très présente. Son financement provient de la publicité en ligne, de l’Initiative de journalisme local (pour le salaire de deux journalistes), de dons individuels des auditeurs (qui s’élèvent à environ 80 000 dollars par an) et même de la vente de produits dérivés chics.
Cabin Radio s’est constitué un public fidèle, avec une moyenne mensuelle d’un million de consultations en ligne dans une ville de 20 000 habitants. Mais ce sont les feux de forêt de 2023 qui ont cimenté sa place au sein de la communauté de Yellowknife. « Nous avons commencé à diffuser des informations en direct 24 heures sur 24, explique M. Williams. Nous sommes devenus en quelque sorte le bureau central d’information. »
Personne d’autre – ni le gouvernement ni les autres médias – ne le faisait. L’audience a grimpé en flèche. « Les gens nous disent régulièrement que nous sommes leur principale source de nouvelles », commente M. Williams, même si la CBC est très présente à Yellowknife et emploie une bonne demi-douzaine de journalistes locaux.
Cabin Radio, dont le capital de départ était de 100 000 dollars, est une entreprise rentable selon M. Williams, en partie parce qu’elle s’est trouvé une autre source de revenus en lançant un service de vidéos commerciales pour les entreprises locales. « Nous rentrons dans nos frais chaque année, affirme M. Williams. L’entreprise est viable. »
Étude de cas no 5 – My Broadcasting Corporation : pas de grand secret dans la sauce
Sur le chandail à capuchon de Jon Pole, on peut lire cinq mots qui guident sa chaîne de stations de radio en pleine expansion : Ne pas abandonner le navire.
Président et cofondateur de My Broadcasting Corporation, qui possède 29 stations de radio dans 17 marchés ontariens, Jon Pole se sert de cette vieille devise de la marine américaine pour garder à l’esprit sa préoccupation centrale : le marché local. « Notre objectif principal est d’être un partenaire de la collectivité et de lui redonner plus que ce que nous lui prenons », explique-t-il.
Lorsque Bell vend 45 de ses 103 stations de radio en 2024, M. Pole en rachète quatre : CJPT-FM et CFJR-FM à Brockville et CKLC-FM et CLFY-FM à Kingston. (Six autres acheteurs – Vista Radio, Whiteoaks Communications Group, Durham Radio, ZoomerMedia, Arsenal Media et Maritime Broadcasting System – font l’acquisition des autres stations.)
À l’époque, Bell déclare que ces stations ne sont « plus des entreprises viables ».
« Je comprends que Bell dise qu’elles ne sont pas viables pour eux, compte tenu des résultats qu’ils ont obtenus », commente M. Pole. Il estime que les stations n’ont pas été assez performantes et qu’il atteindra la rentabilité avec ses nouvelles acquisitions en mettant l’accent sur le contenu local, comme il l’a fait à maintes reprises avec sa chaîne de stations en pleine expansion : « La différence sera que nous aurons plus de nouvelles locales, plus de vendeurs, plus d’activités au sein de la communauté, et que les revenus seront nettement plus importants. »
En attendant l’approbation de la vente par le CRTC, ce qui prend environ un an (« trop longtemps », selon M. Pole), des projets sont en cours pour créer des services d’information radiophonique dans les deux collectivités. C’est une recette que M. Pole réutilise sur chaque marché qu’il perce. Dans toutes les enquêtes menées auprès des auditeurs depuis le lancement de sa société il y a 20 ans, les nouvelles locales figurent selon lui en tête de liste des éléments que les auditeurs apprécient dans les stations (avant la musique, les concours et la personnalité des animateurs). Et lorsqu’on investit dans une force de vente locale solide, les annonceurs suivent.
« Il n’y a pas de grand secret dans la sauce et, d’ailleurs, il n’y a pas vraiment de secret, lance M. Pole. Taylor Swift ne chante pas mieux pour nous que pour n’importe qui d’autre. »
CHAPITRE TROIS – La conférence de Charlottetown
En octobre 2024, dans une salle de conférence haute de plafond avec vue sur le port de Charlottetown (Î.-P.-É.) accueille plus de 60 professionnels parmi les plus novateurs de l’information locale de tout le pays, des personnes dont les activités modestes, souvent menées dans des endroits reculés, les isolent généralement les unes des autres.
Ces professionnels font part de leur épuisement, celui qui ne peut découler que du travail solitaire effectué dans un secteur précaire et en perte de vitesse, lorsqu’on fait face à des vents contraires impitoyables.
Mais ces entrepreneurs de l’information locale sont également animés d’un sentiment d’espoir palpable. En effet, la Fondation Rideau Hall et la Fondation des prix Michener les ont fait venir de tout le Canada pour qu’ils réfléchissent aux moyens de permettre à leur industrie de survivre – et peut-être même de prospérer. Certains exploitent des publications imprimées dans de petites villes, d’autres dirigent des jeunes pousses numériques dans de grandes villes; certains n’ont que deux employés, d’autres sont à la tête de grandes entreprises médiatiques.
Unis dans leur mission d’information locale, ils sont aussi là, en partie, pour retrouver leur allant. Ceux qui travaillent sur le terrain des médias locaux sont pragmatiques : ils font avancer les choses, souvent contre vents et marées. Ils sont là pour trouver des solutions.
Les médias représentés à Charlottetown sont tous détenus et exploités localement. Il a été difficile de réunir leurs représentants. La plupart déclarent profiter des programmes de soutien gouvernementaux mis en place au cours des dernières années, depuis qu’il est admis que la crise des médias d’information est également une crise de la démocratie et, souvent, qu’elle implique la survie même de ces médias. Tous sont parfaitement conscients qu’ils se réunissent à un moment où ce soutien ne peut plus être considéré comme acquis.
Les trois mesures mises en place à la suite du budget fédéral de 2019 – en particulier le Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne[33] et l’Initiative de journalisme local (IJL)[34] – ont apporté un soutien important aux médias locaux à travers le Canada. Le crédit d’impôt est de 25 % (et a été porté temporairement à 35 %) du salaire des journalistes, tandis que l’IJL finance environ 400 postes pour la couverture des nouvelles locales.[35]
Les trois quarts des participants à la conférence de Charlottetown déclarent bénéficier d’au moins un programme. L’Initiative de journalisme local est citée par le plus grand nombre, suivie du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre et du Fonds du Canada pour les périodiques[36]. Pour près du quart des participants, ces aides représentent jusqu’à 25 % de leurs revenus.
Grâce à ces programmes gouvernementaux, les organes de presse peuvent se permettre d’employer, en moyenne, un ou deux journalistes de plus qu’ils ne le feraient autrement, ce qui change la donne pour les petites rédactions comptant une demi-douzaine d’employés ou moins.
Malheureusement, ces programmes sont devenus très politisés, comme le reconnaissent les éditeurs et les rédacteurs en chef réunis à Charlottetown.[37] Ceux-ci insistent sur le fait que les programmes gouvernementaux qui apportent un soutien important à l’information locale ne doivent pas être partisans et qu’il ne faut pas non plus les associer à des débats nationaux litigieux, tels que l’avenir de CBC/Radio-Canada. Il faut plutôt les considérer comme un outil politique visant à promouvoir un débat et un contenu locaux solides, quelle que soit l’orientation politique d’une collectivité.
La grande majorité de ces éditeurs et rédacteurs en chef déclarent dans un sondage qu’ils « ne craignent pas du tout » que le soutien du gouvernement au journalisme compromette l’indépendance éditoriale – beaucoup se disent habitués à faire face à la pression des annonceurs et à protéger leur indépendance –, mais le grand public, lui, ne semble pas de cet avis. Les résultats du sondage Ipsos montrent que 71 % des Canadiens craignent que l’indépendance soit compromise par le financement public.
Certes, les rédacteurs en chef et les éditeurs craignent que l’ensemble des programmes gouvernementaux destinés aux médias (voir l’annexe) mette à l’épreuve la patience des contribuables. « Les médias en ont trop demandé, commente l’un d’eux, cela ressemble à de l’assistanat. » Un autre ajoute : « Le public ne s’y retrouve pas dans les différentes subventions. Je pense que nous devons mettre de l’ordre dans notre action. »
Même les professionnels de l’information ont du mal à se tenir au courant des différents programmes et à maîtriser les processus de candidature pour se qualifier. En dehors du Québec, rares sont ceux qui connaissent le statut d’organisation journalistique enregistrée (OJE) et les portes qui peuvent s’ouvrir pour le soutien philanthropique. « Je n’en avais pas eu connaissance jusqu’à aujourd’hui », regrette un rédacteur en chef. (Le gouvernement fédéral aurait avantage à évaluer l’adoption du statut d’OJE au Québec et à déterminer la façon dont le reste du Canada peut suivre cet exemple.)
Beaucoup se montrent néanmoins intéressés par le potentiel des modèles philanthropiques de soutien aux entreprises locales. Ces modèles sont largement utilisés au Québec et sont assez courants aux États-Unis, en particulier pour les organes de presse ayant une mission ou un objectif social explicite, comme le journalisme d’enquête. (Le sondage Ipsos[38] révèle une volonté de donner : 40 % des répondants déclarent qu’ils envisageraient de faire un don à un organe de presse local en échange d’un reçu fiscal). Selon certains, en reliant le journalisme local à la santé politique et sociale globale d’une collectivité, on pourrait ouvrir la voie à un soutien de la part de fondations caritatives et de donateurs individuels. Certains participants suggèrent de charger quelqu’un de l’orientation des petits médias dans le dédale des programmes gouvernementaux.
La plupart des rédacteurs en chef et des éditeurs souhaitent que les mesures de soutien du gouvernement, en particulier le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique, soient maintenues indéfiniment. Certains soulignent toutefois les lacunes de ces programmes et suggèrent que les médias soient autorisés à y accéder pour une période plus courte, de deux ou trois ans peut-être. Selon d’autres, ces programmes ne devraient pas être accessibles aux grandes entreprises médiatiques ou devraient être liés au maintien des emplois de journalistes locaux.
Presque tous s’entendent pour dire qu’il faudrait inciter davantage les annonceurs à soutenir les médias locaux, en particulier en accordant un crédit d’impôt aux entreprises locales qui font de la publicité localement, ce qui remettrait la décision de financement entre les mains des entreprises. Dans une certaine mesure, cela est vrai également pour les dons de charité et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique. Dans le premier cas, ce sont les donateurs qui décident. Dans le second, le crédit d’impôt est automatique pour toute organisation qui emploie des journalistes (et qui est désignée comme organisation journalistique canadienne qualifiée).[39]
Selon de nombreux participants à la conférence, les gouvernements devraient eux aussi consacrer plus d’argent à la publicité dans les médias locaux et communautaires. Ils pourraient suivre l’exemple, entre autres, du gouvernement de l’Ontario, qui, en juillet 2024, s’est engagé à consacrer 25 % de son budget publicitaire à des « éditeurs basés en Ontario ».[40] La province débourse environ 200 millions de dollars par an en publicité gouvernementale, notamment pour les dépenses de marketing de quatre grandes agences provinciales : la Régie des alcools de l’Ontario, la Société ontarienne du cannabis, Metrolinx et la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Un quart de cette somme représenterait 50 millions de dollars par an en recettes publicitaires pour les éditeurs ontariens. (Selon le sondage Ipsos, 67 % des Canadiens pensent que les gouvernements devraient attribuer une plus grande part de leur budget publicitaire aux médias locaux.)[41]
Si de tels programmes étaient adoptés par les gouvernements de tout le pays, à tous les niveaux, cela pourrait changer la donne pour les médias locaux. Un refrain souvent entendu : « Si nous pouvions simplement obtenir leur publicité, nous n’aurions pas besoin de programmes de subvention. »
CHAPITRE QUATRE – L’intervention des pouvoirs publics
Au Canada, les politiques publiques de soutien au journalisme existaient avant la Confédération, en commençant par la subvention postale pour les journaux, suivie par le financement gouvernemental de la première agence de transmission internationale du Canada, la Canadian Associated Press, et plus tard, par la création de CBC/Radio-Canada et l’établissement du Fonds du Canada pour les périodiques. Toutes ces initiatives reposaient sur le principe selon lequel les nouvelles par et sur les Canadiens sont importantes pour la réussite du pays et que tous les citoyens doivent avoir un accès égal à ces nouvelles.
Les arguments en faveur d’un soutien public aux médias d’information ont toujours été fondés sur l’importance du journalisme pour garantir la santé du discours démocratique et de la vie de la communauté, mais ce soutien est plus urgent que jamais.
Le rapport The Shattered Mirror (Le miroir éclaté)[42] publié en 2017 par le Forum des politiques publiques affirmait que l’effondrement des modèles économiques traditionnels empêchait les médias de continuer à exercer le « journalisme civique » des décennies passées. Huit ans plus tard, ce constat est plus patent que jamais. Au Canada, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures de soutien, notamment le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique en 2019, ainsi que le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques et la création du statut d’organisation journalistique enregistrée (OJE) sans but lucratif. L’Initiative de journalisme local a été lancée à titre de programme quinquennal; elle a été renouvelée pour trois années supplémentaires.
Bien que les programmes actuels aient été lancés sous un gouvernement fédéral libéral, la survie du « journalisme civique », en particulier au niveau local, est une question transpartisane. Les conservateurs peuvent préférer un engagement plus local et des choix dirigés par les consommateurs, mais tous les partis ont intérêt à ce que le public soit bien informé et ait accès à un écosystème dynamique de médias locaux. Des médias florissants, indépendants et détenus localement sont essentiels à la santé sociale des communautés, quelle que soit la couleur politique de leurs dirigeants. Il n’existe pas d’approche politique unique qui puisse aider tous les médias locaux; en effet, l’histoire, les modèles d’entreprise et les objectifs des organes de presse varient grandement de l’un à l’autre. L’éventail des aides publiques ne doit pas faire de distinction entre les médias établis et les nouvelles entreprises, entre la presse écrite, la presse numérique et la radiodiffusion, ou entre les modèles à but lucratif et ceux à but non lucratif. Les politiques publiques ne doivent pas chercher à préserver les médias tels que nous les connaissons, mais doivent plutôt se concentrer sur les innovations qui contribueront à maintenir un flux de nouvelles fiables, quel que soit le canal de distribution – et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un financement public perpétuel.
Les politiques publiques doivent faire du bien public leur absolue et unique priorité.
En gardant ce principe central à l’esprit, nous proposons, dans les pages suivantes, neuf pistes variées, complémentaires, superposables et durables qui permettraient aux gouvernements, aux philanthropes et aux consommateurs d’assurer un avenir stable aux médias locaux du Canada.
POUR LES PHILANTHROPES
Élargir la définition de la question – Aux États-Unis, la philanthropie soutenant l’information locale se développe rapidement. Outre la petite poignée de fondations américaines qui s’intéressent au journalisme et à la démocratie, une deuxième vague de fondations et de donateurs qui consacraient des fonds à d’autres questions – notamment la violence familiale, la faim, l’itinérance et la pauvreté – se sont rendu compte qu’ils n’avanceraient pas sans nouvelles locales. Les philanthropes canadiens devraient suivre cet exemple.
Accroître la participation des fondations communautaires – Le Canada compte plus de 200 fondations communautaires et des milliers de fondations privées. Ces fondations commencent tout juste à canaliser leur impressionnante capacité de collecte de fonds vers des initiatives d’information locales : la Winnipeg Community Foundation, par exemple, a financé des reportages sur la religion réalisés par le Free Press de Winnipeg; la Toronto Foundation est l’une des nombreuses fondations qui contribuent au financement de The Local. Il faut inciter les fondations communautaires à soutenir la couverture de l’actualité locale dans le cadre de leurs missions plus larges visant à encourager la vitalité sociale, la santé communautaire et la démocratie locale. Un plus grand nombre d’organes médiatiques devraient frapper à ces portes, et un plus grand nombre de fondations communautaires devraient intervenir.
Contribuer à la mise en place de nouveaux modèles d’information locale, dont des OSBL caritatifs – Les principaux organes médiatiques francophones, tels que La Presse et Le Devoir, sont devenus des OSBL et ont ensuite utilisé ce statut pour demander celui d’organisation journalistique enregistrée afin de pouvoir profiter de l’argent des fondations et des donateurs individuels. À l’extérieur du Québec, seuls cinq organes médiatiques ont fait de même. Il y a là une occasion manquée de développer une nouvelle source de revenus pour soutenir l’information locale. Le statut d’OJE permettrait à des jeunes pousses de recevoir un soutien philanthropique ou leur offrirait la possibilité de recueillir des fonds de leur communauté afin de relancer la couverture locale que les grandes chaînes médiatiques ont abandonnée.
Les fondations peuvent aider les organes de presse à franchir cette étape. Il peut être compliqué d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance, mais les fondations peuvent offrir des conseils sur la manière de s’y retrouver dans les règles relatives aux organismes philanthropiques enregistrés, par exemple sur la création d’organismes de bienfaisance « amis », qui ont plus de facilité à recueillir des fonds auprès de donateurs. Si davantage d’organes de presse avaient le statut d’organisme de bienfaisance, le journalisme local pourrait bénéficier d’une aide plus importante de la part des fondations.
POUR LE GOUVERNEMENT
Reconcevoir l’Initiative de journalisme local – L’organisme américain Report for America est un bon modèle de partenariat à visée stratégique qui renforce les capacités à long terme plutôt que de combler les lacunes à court terme. Ayant pour mission déclarée de « renforcer [les] communautés et [la] démocratie grâce au journalisme local », il finance des journalistes dans les rédactions locales pour des mandats de trois ans (au lieu d’un seul ou moins avec l’IJL). Il a d’autres vertus : il offre une formation aux journalistes (contrairement à l’IJL); ses subventions diminuent chaque année, ce qui fait en sorte que la charge du financement de l’effectif est transférée petit à petit au média; enfin, il aide les organes de presse à apprendre à recueillir des fonds au sein de leur communauté. Un organisme du même ordre pensé pour le Canada engrangerait davantage de fonds pour l’IJL, parallèlement à ceux investis par les philanthropes. Il offrirait ainsi l’avantage supplémentaire d’éloigner le programme du gouvernement en place; l’autorité de cet organisme serait confiée à un conseil d’administration indépendant. Les contributions publiques prendraient la forme d’un financement pluriannuel, comme dans le cas des organismes qui subventionnent la recherche universitaire.
Imposer une période de préavis de vente – Les communautés devraient avoir la possibilité de soutenir les organes de presse menacés de fermeture par les entreprises propriétaires. Plus précisément, il faudrait prévoir une période de préavis (de 120 jours, par exemple) avant la fermeture d’un média ou sa vente à un acheteur non local. Les collectivités auraient ainsi le temps de rassembler des soutiens en faveur de la propriété locale. Pour appuyer les acheteurs locaux, les gouvernements peuvent envisager des interventions politiques qui incluraient la formation et le développement, le soutien à la restructuration des opérations, l’accès à des ressources spécialisées, du soutien pour s’y retrouver dans les programmes fédéraux et provinciaux, ainsi que des prêts à faible coût ou sans frais.
Lier le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre à l’emploi – Ce crédit d’impôt est actuellement le programme gouvernemental le plus important pour le soutien aux organes de presse; sa valeur est estimée à 67 millions de dollars pour l’année fiscale 2024-2025. Il faut le maintenir, mais en y apportant des changements importants. En effet, il ne faut pas que les médias prennent l’argent tout en réduisant le contenu : le crédit d’impôt doit les inciter à repeupler les rédactions et doit être lié à l’augmentation ou à la préservation des postes de journalistes et des autres ressources nécessaires à la production de nouvelles locales. Le crédit d’impôt serait plus élevé pour ceux dont les dépenses journalistiques augmentent.
Encourager la publicité locale par une baisse d’impôt – Dans le même ordre d’idées, les annonceurs locaux devraient bénéficier d’un crédit d’impôt pour leurs dépenses publicitaires dans des médias indépendants et locaux. Alors que l’argent de la publicité continue d’affluer vers des sites numériques étrangers, privant ainsi les médias locaux des fonds dont ils ont besoin, un crédit d’impôt inciterait davantage les annonceurs à voter local, tout en leur laissant le soin – et non au gouvernement – de choisir les médias qu’ils soutiendront. Des crédits d’impôt équitables, pour les annonceurs présentent l’avantage supplémentaire d’être plus susceptibles de perdurer en dépit des changements d’orientation politique. Cela dit, la publicité locale n’est utile que si les commerçants locaux sont en mesure de résister à la concurrence des détaillants numériques distants, ce qui est une tout autre histoire.
Diriger l’argent de la publicité gouvernementale vers les médias locaux – Les gouvernements devraient réserver une partie de leurs importants budgets publicitaires aux éditeurs et diffuseurs locaux. L’Ontario montre la voie en exigeant que 25 % des budgets publicitaires du gouvernement, notamment les dépenses de quatre grandes agences provinciales, soient dirigés vers des « éditeurs basés en Ontario ». Ce programme entré en vigueur en septembre 2024 vise explicitement à « contribuer à soutenir ces éditeurs et leurs travailleurs, qui créent du contenu d’information locale pour les habitants de toute la province ». Mis en place par un gouvernement conservateur, il pourrait rapporter quelque 50 millions de dollars par an aux éditeurs ontariens. Le gouvernement fédéral, les autres provinces et territoires, ainsi que les municipalités devraient suivre cet exemple. Les gouvernements dépensent déjà des sommes considérables en publicité et en marketing. Il est absurde pour eux de parler de la nécessité d’une démocratie locale dynamique et d’un environnement de médias locaux sain alors qu’ils continuent à canaliser leurs propres dépenses publicitaires vers des sites de médias sociaux appartenant à des intérêts étrangers.
POUR LES PHILANTHROPES ET LE GOUVERNEMENT
Encourager la formation de capital – La meilleure façon de renforcer l’information locale est de l’aider à rester entre les mains de la population locale, sous la forme que les entrepreneurs jugent la plus efficace dans chaque collectivité. Dans de nombreux cas, cela nécessitera des capitaux. Des programmes visant à encourager la formation de capital à cette fin contribueraient grandement à préserver le bien public que constituent les nouvelles locales. Un véhicule d’investissement durable, cofinancé par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux, le secteur philanthropique et les ONG, pourrait s’inspirer de programmes gouvernementaux tels que le Fonds de finance sociale[43] et le Fonds canadien de protection des loyers[44]; le gouvernement fédéral y est un investisseur dans un véhicule d’investissement visant à assurer la durabilité d’un secteur et à rassembler des fonds publics, privés et philanthropiques. Le gouvernement devrait explorer tout mécanisme qui rendrait l’attraction des fonds plus efficace, à l’aide de la méthode « premier entré, dernier sorti ». Les médias locaux constituent une occasion d’investissement idéale pour les organismes philanthropiques visant le meilleur impact social. Il en va de même pour les gouvernements, qui ont déjà mis en place des mesures d’encouragement du régime d’actionnariat des salariés, ce qui pourrait faciliter le rachat d’un journal par ses employés.
CONCLUSION
Depuis des années, l’historien Timothy Snyder, auteur du succès de librairie De la tyrannie : vingt leçons du XXe siècle, nous met en garde contre les menaces qui pèsent sur la démocratie dans des pays allant de l’Ukraine aux États-Unis. Son principal message est le suivant : il est rare que la démocratie disparaisse à grand fracas; au contraire, elle s’érode généralement de l’intérieur lorsque les citoyens cessent d’apprécier les institutions qui contribuent à sa vitalité.
L’information locale est « extrêmement importante pour la démocratie », dit l’auteur,[45] mais elle est aussi « largement sous-estimée ».
Nous sommes d’accord. Certes, le journalisme local ne résoudra pas tous nos maux. Mais nous ne pouvons ni traiter, ni apprendre à apprécier ce qui est invisible à nos yeux, notamment les questions et les problèmes que seul le journalisme peut mettre en lumière. Ce qui est en jeu, ce n’est rien de moins que la santé sociale et politique des collectivités à travers le pays. La démocratie, comme on le dit souvent, meurt dans l’obscurité.
Nous sommes tous concernés par la recherche de solutions. Les gouvernements doivent canaliser une partie de leur budget publicitaire dans les petites communautés; ils doivent donner à celles-ci la possibilité de soutenir les organes de presse menacés de fermeture; et ils doivent permettre aux entreprises et aux consommateurs d’appuyer davantage d’organes médiatiques de leur choix. Les philanthropes doivent renforcer l’engagement des fondations communautaires, en cessant de s’intéresser au financement d’un seul sujet pour comprendre de manière plus globale le rôle du journalisme dans la sensibilisation et l’obligation de rendre des comptes. Ensemble, le gouvernement et le secteur philanthropique devront créer un nouvel organisme, indépendant et doté d’un financement durable, qui contribuera à former la prochaine génération de journalistes locaux, tant dans le domaine du journalisme que dans celui de la collecte de fonds.
Plus important encore, les entrepreneurs de l’information doivent s’efforcer – comme ils l’ont fait à The Local et The Eastern Door, CHEK-TV, My Broadcasting Corporation, Cabin Radio, Crowsnest Pass Herald et Haida Gwaii News – de trouver de nouveaux moyens d’identifier les possibilités qui s’offrent à eux et de mieux servir leurs communautés locales, en utilisant les nouveaux systèmes de diffusion, les reportages à l’ancienne et les modèles de financement créatifs qu’ils peuvent réunir pour faire circuler des nouvelles fiables.
Les communautés canadiennes ne méritent rien de moins.
Annexe – Les programmes de soutien existants
Fonds du Canada pour les périodiques : Mis en place en 2009, le fonds a remplacé deux programmes antérieurs conçus pour aider les magazines imprimés canadiens, les journaux communautaires et les médias numériques. Il comprend une version du programme d’aide aux publications (pour la distribution postale) en vigueur depuis plus d’un siècle, ainsi que d’autres types d’aide aux journaux et magazines communautaires. Le financement prévu est de 86,5 millions de dollars pour 2024-2025.
Patrimoine Canada (n. d.). Fonds du Canada pour les périodiques. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-periodiques.html
Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne : Annoncée dans le budget fédéral de 2019 dans le cadre d’un ensemble de mesures de soutien aux médias d’information, cette mesure devait coûter 595 millions de dollars sur cinq ans. Elle offrait un crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les salaires allant jusqu’à 55 000 dollars par an versés aux employés des salles de rédaction des organisations journalistiques canadiennes qualifiées (OJCQ). En 2023, le crédit d’impôt a été porté à 35 % pour une période de quatre ans, et le coût maximal pouvant être déduit par employé a été porté de façon permanente à 85 000 dollars. Le directeur parlementaire du budget estime que le programme amélioré coûtera 320 millions de dollars sur quatre ans.
Agence du revenu du Canada (n. d.). Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne.html
Crédit d’impôt pour soutien à la presse d’information écrite (Québec) : Également mise en place en 2019, cette mesure offre un crédit d’impôt remboursable de 35 % des salaires (allant jusqu’à 75 000 $ par an) des employés des organisations admissibles qui publient des contenus imprimés originaux « s’adressant spécifiquement à la population du Québec ». Les contenus doivent porter sur des sujets d’actualité tels que la politique, les affaires et les nouvelles locales. Les employés admissibles sont ceux qui participent à la rédaction, à l’édition, à la recherche, à la photographie et à d’autres « activités de préparation du contenu ». Le Québec a budgétisé un coût de 64,7 millions de dollars sur cinq ans pour le programme.
Auteur inconnu (n. d.). Crédit d’impôt pour soutenir la presse d’information écrite. Investissement Québec. https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/credits-d-impot/Credit-d-impot-pour-soutenir-la-presse-d-information-ecrite.html
Initiative de journalisme local : Lancée en 2019 pour cinq ans, cette mesure est destinée à soutenir la création d’un « journalisme civique original », en particulier dans les communautés mal desservies. En 2022-2023, l’IJL a permis aux organes de presse d’embaucher ou de maintenir en poste plus de 400 journalistes. Le programme a été prolongé de trois ans en 2024, ce qui porte le financement à 128,8 millions de dollars sur huit ans. Ce financement est administré par sept groupes indépendants du gouvernement, dont Médias d’Info Canada et le Fonds canadien de la radio communautaire.
Patrimoine Canada (n. d.). Initiative de journalisme local. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/initiative-journalisme-local.html
Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques : Annoncée dans le budget fédéral de 2019, cette mesure offre un crédit d’impôt sur le revenu des particuliers non remboursable de 15 % pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles jusqu’à 500 dollars par an, pour un avantage maximal de 75 dollars. Les abonnements admissibles doivent être souscrits auprès d’une OJCA dont l’activité principale est la production de contenu écrit. Ce crédit doit expirer en 2025.
Agence du revenu du Canada (n. d.). Au sujet du crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/toutes-deductions-tous-credits-toutes-depenses/abonnement-aux-actualites-numeriques.html
Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires : En octobre 2024, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 12,5 millions de dollars sur cinq ans dans ce fonds, lancé en 2018 afin de soutenir des projets qui contribuent à la vitalité des médias de langue officielle en situation minoritaire. Une partie de cette somme servira à créer 125 stages dans 98 organes de presse communautaires à travers le Canada.
Patrimoine Canada (28 oct. 2024). Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 12,5 millions de dollars pour soutenir les médias communautaires dans les communautés vivant en situation minoritaire. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2024/10/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-investissement-de-125-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-medias-communautaires-dans-les-communautes-vivant-.html
Organisation journalistique enregistrée : Cette désignation permet aux organisations journalistiques d’obtenir le statut d’organisme sans but lucratif et de délivrer des reçus fiscaux pour les dons de charité provenant de fondations, d’entreprises et de particuliers. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. En décembre 2024, il y avait 12 OJE au Canada, dont sept au Québec. Pour obtenir le statut d’OJE, un média doit remplir certaines conditions, notamment être une organisation journalistique canadienne admissible (OJCA), fonctionner comme un organisme sans but lucratif, employer au moins deux journalistes et ne pas accepter de dons d’une seule source qui représenteraient plus de 20 % de ses revenus.
Agence du revenu du Canada (31 oct. 2024). Liste des organisations journalistiques enregistrées. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/listes-autres-donataires-reconnus/liste-organisations-journalistiques-enregistrees.html
Fonds pour la diversité des voix : Le budget fédéral de 2024 a engagé 10 millions de dollars sur trois ans pour aider les « communautés diverses » (notamment les Autochtones, les Noirs et les personnes handicapées) à diffuser leurs récits et leurs points de vue. L’argent doit être distribué en partie par l’intermédiaire de l’Initiative de journalisme local.
Patrimoine Canada (n. d.). Le Fonds pour la diversité des voix. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-diversite-voix.html
Publicité du gouvernement de l’Ontario : En juillet 2024, l’Ontario s’est engagé à ce que 25 % des budgets publicitaires du gouvernement et de ses plus grandes agences soient réservés à des éditeurs basés en Ontario. Cette directive inclut les dépenses de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), de la Société ontarienne du cannabis, de Metrolinx et de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Ces agences dépensent environ 100 millions de dollars par an en publicité et en marketing, tandis que le gouvernement lui-même en dépense également 100. Le gouvernement a déclaré que la mesure était destinée à soutenir les éditeurs « qui créent du contenu d’information locale pour les habitants de toute la province ».
Cabinet du premier ministre (3 juill. 2024). La province protège les emplois de l’Ontario grâce à une nouvelle directive sur la publicité. Gouvernement de l’Ontario. https://news.ontario.ca/fr/bulletin/1004801/la-province-protege-les-emplois-de-lontario-grace-a-une-nouvelle-directive-sur-la-publicite
Loi sur les nouvelles en ligne – Fonds de Google : En 2023, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur les nouvelles en ligne (le projet de loi C-18) qui exige des plateformes Web qu’elles dédommagent les organes de presse pour l’utilisation de leur contenu. En conséquence, Meta a cessé de placer des liens vers les contenus d’information canadiens sur ses plateformes, notamment Facebook et Instagram. Google a négocié un accord pour la création d’un fonds d’une valeur de 100 millions de dollars par an à distribuer entre les médias canadiens. En juin 2024, le géant du numérique a signé une entente avec le Collectif canadien de journalisme, qui représente des éditeurs et diffuseurs indépendants, pour superviser l’allocation des fonds; il a transféré l’argent au collectif au début de 2025.
Djuric, M. (7 juin 2024). Google signs deal with organization to distribute $100M to Canadian news companies. CBC. https://www.cbc.ca/news/politics/google-canadian-news-companies-1.7228190
Notes en fin de texte
- Wyton, M. (9 juill. 2024). After four years, a newspaper returns to Haida Gwaii. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-after-four-years-a-printed-newspaper-returns-to-haida-gwaii/ ↑
- Local News Research Project (3 déc. 2024). The Local News Map. Toronto Metropolitan University and University of British Columbia. https://s35582.pcdn.co/wp-content/uploads/2024/12/LocalNewsMapDataDecember2024.pdf ↑
- Farhi, P. (29 oct. 2024). All the News That’s Missing in Cairo. Local News Initiative, Medill University. https://localnewsinitiative.northwestern.edu/posts/2024/10/29/cairo-news-desert/ ↑
- Hayes, D. et Lawless, J.L. (2021). News Hole: The Demise of Local Journalism and Political Engagement. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/news-hole/86C7B8933122EB6EC229E4B05BBAA27C ↑
- Angelucci, C., Cagé, J. et Sinkinson, M. (mai 2024). Media Competition and News Diets. American Economic Journal, 16(2), 62-102. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/mic.20220163 ↑
- Taylor, S.D. (2019). The Decline of Local News and its Effect on Polarization. Governance: The Political Science Journal at UNLV. https://digitalscholarship.unlv.edu/governance-unlv/vol6/iss2/2/ ↑
- Auteur inconnu (n. d.). Local News Research Project. Toronto Metropolitan University. https://localnewsresearchproject.ca/ ↑
- Local News Map (3 déc. 2024). Local News Research Project. School of Journalism, Toronto Metropolitan University. https://s35582.pcdn.co/wp-content/uploads/2024/12/LocalNewsMapDataDecember2024.pdf ↑
- Ipsos Public Affairs (27 janv. 2025). Local Media Study in Canadian Communities. Public Policy Forum. https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2025/02/LocalMediaPoll2025-IPSOS.pdf ↑
- Patrimoine canadien (n. d.). La Loi sur les nouvelles en ligne. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/nouvelles-en-ligne.html ↑
- Castaldo, J. (24 janv. 2023). Postmedia to lay off 11% of editorial staff amid rising costs, declining advertising. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-postmedia-layoffs-11-per-cent-staff/ ↑
- Willis, A. et Castaldo, J. (15 sept. 2023). Nordstar to put Metroland newspaper group into bankruptcy, more than 70 weekly papers to go digital only. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-nordstar-puts-metroland-newspaper-group-into-bankruptcy-more-than-70/ ↑
- Auteur inconnu (26 juill. 2024). Postmedia Enters Agreement to Acquire Saltwire. Postmedia. https://www.postmedia.com/2024/07/26/postmedia-enters-agreement-to-acquire-saltwire/ ↑
- La Presse canadienne (26 août 2024). Postmedia completes $1-million purchase of Atlantic Canada’s largest newspaper chain. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-postmedia-completes-1-million-purchase-of-atlantic-canadas-largest/ ↑
- Pereira, A. (26 juill. 2024). Corus Entertainment to slash 300 more jobs by August in ‘aggressive’ bid to stop the bleeding. Toronto Star. https://www.thestar.com/business/corus-entertainment-to-slash-300-more-jobs-by-august-in-aggressive-bid-to-stop-the/article_ecc6c380-42b6-11ef-8cc0-139e977bd232.html ↑
- Hudes, S. (8 fév. 2024). Bell to cut 4.8K jobs, sell 45 radio stations in major shake-up. Global News. https://globalnews.ca/news/10280833/bell-layoffs-january-2024/ ↑
- Joannou, A. (20 déc. 2023). ‘A front row to our funeral’: Canadian local news coverage erodes in 2023. National Post. https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/a-front-row-to-our-funeral-canadian-local-news-coverage-erodes-in-2023 ↑
- Auteur inconnu (1er août 2024). Old News, New Reality: A Year of Meta’s News Ban in Canada. Media Ecosystem Observatory. https://meo.ca/press/old-news-new-reality-a-year-of-metas-news-ban-in-canada ↑
- Patel, R. (1er août 2024). ‘Extremely bad news’: Canadians are encountering fewer legitimate news sources on social media, study finds. Toronto Star. https://www.thestar.com/politics/federal/extremely-bad-news-canadians-are-encountering-fewer-legitimate-news-sources-on-social-media-study-finds/article_39f75df0-503a-11ef-9a75-ef31cbf701ed.html ↑
- Paikin, S. (24 sept. 2024). How Has Meta’s News Ban Affected Canadians? The Agenda, TVO. https://www.youtube.com/watch?v=gVmBfEPoTi4 ↑
- Cabin Radio. https://cabinradio.ca/ ↑
- The Local. https://thelocal.to/ ↑
- The Wren. https://thewrennews.ca/ ↑
- Kamloops Chronicle. https://kamloopschronicle.com/ ↑
- Ipsos Public Affairs (27 janv. 2025). Local Media Study in Canadian Communities. Public Policy Forum. https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2025/02/LocalMediaPoll2025-IPSOS.pdf ↑
- Dufour, A. (4 oct. 2024). ‘Our chance to fight back’: local news outlet Village Media launches social media platform. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/facebook-group-spaces-soo-communities-1.7342167 ↑
- Agence du revenu du Canada (31 oct. 2024). Liste des organisations journalistiques enregistrées. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/listes-autres-donataires-reconnus/liste-organisations-journalistiques-enregistrees.html ↑
- Auteur inconnu (n. d.). About Report for America. The Groundtruth Project. https://www.reportforamerica.org/about-us/ ↑
- Auteur inconnu (7 juin 2024). Google nomme un organisme pour répartir les 100 millions $ promis aux médias canadiens. Radio-Canada. Google nomme un organisme pour répartir les 100 millions $ promis aux médias canadiens | Radio-Canada ↑
- Auteur inconnu (n. d.). About the Canadian Journalism Collective. https://cjc-ccj.ca/en/ ↑
- Fenlon, B. (15 janv. 2025). Local news matters: CBC to hire more journalists, launch new platforms. CBC. https://www.cbc.ca/news/editorsblog/editor-s-blog-local-news-cbc-hires-1.7430811 ↑
- Doolittle, R. (20 mars 2024). How third-party funding allowed a tiny newspaper to wage legal warfare against Google and Meta. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-omni-bridgeway-commercial-lawsuits/ ↑
- Agence du revenu du Canada (n. d.). Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne.html ↑
- Patrimoine canadien (n. d.). Initiative de journalisme local. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/initiative-journalisme-local.html ↑
- Patrimoine canadien (1er mars 2024). Soutien au journalisme local indépendant, car la population mérite d’être informée. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2024/03/soutien-au-journalisme-local-independant-car-la-population-merite-detre-informee.html ↑
- Patrimoine Canada (n. d.). Fonds du Canada pour les périodiques. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-periodiques.html ↑
- Wright, R. (14 août 2024). Poilievre questions government supporting local journalism. Niagara Now. https://niagaranow.com/news.phtml/poilievre-questions-government-supporting-local-journalism/ ↑
- Ipsos Public Affairs (27 janv. 2025). Local Media Study in Canadian Communities. Public Policy Forum. https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2025/02/LocalMediaPoll2025-IPSOS.pdf ↑
- Agence du revenu du Canada (n. d.). Organisation journalistique canadienne qualifiée. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne/organisation-journalistique-canadienne-qualifiee.html ↑
- Cabinet du premier ministre (3 juill. 2024). La province protège les emplois de l’Ontario grâce à une nouvelle directive sur la publicité. Gouvernement de l’Ontario. https://news.ontario.ca/fr/bulletin/1004801/la-province-protege-les-emplois-de-lontario-grace-a-une-nouvelle-directive-sur-la-publicite ↑
- Ipsos Public Affairs (27 janv. 2025). Local Media Study in Canadian Communities. Public Policy Forum. https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2025/02/LocalMediaPoll2025-IPSOS.pdf ↑
- Greenspon, E. (janv. 2017). Le miroir éclaté. Forum des politiques publiques. https://ppforum.ca/fr/project/the-shattered-mirror/ ↑
- Emploi et Développement social Canada (n. d.). À propos du fonds de finance sociale. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/fonds-finance-sociale.html ↑
- Cabinet du premier ministre (4 avr. 2024). Nous protégeons et agrandissons le parc de logements abordables. Gouvernement du Canada. https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2024/04/04/nous-protegeons-et-agrandissons-parc-delogementsabordables ↑
- Burnett, S. (15 juin 2021). How local journalism can help rebuild democracy. Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/how-local-journalism-can-help-rebuild-democracy/a-57902714 ↑