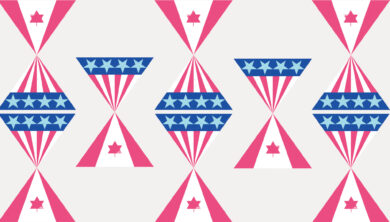Renverser le cours des choses
Pour une pleine inclusion économique et financière au CanadaRésumé
Dans notre démocratie libérale, chaque être a droit à des possibilités économiques qui lui permettent de répondre à ses besoins matériels de base et d’accumuler des richesses, c’est-à-dire de posséder plus que ce dont il a besoin pour simplement survivre.
Dans la réalité pourtant, un nombre surprenant de personnes ne bénéficient pas de ce libre accès à l’économie. Selon les données du Financial Resilience Institute (l’étude sur le bien-être financier [Financial Well-Being Study] et l’indice de résilience financière [Seymour Financial Resilience Index®], tous deux datés d’octobre 2023), plus de six millions de personnes au Canada se heurtent à des obstacles lorsqu’elles veulent gagner de l’argent et sont actuellement incapables de réaliser leur plein potentiel.
Ainsi, malgré l’abondance des initiatives gouvernementales visant à favoriser l’inclusion, l’exclusion économique et financière persiste. Or, si l’on veillait à ce qu’un grand nombre de Canadien·ne·s soient en mesure de participer pleinement à l’économie, le PIB du Canada pourrait augmenter de 10 %. Cette participation pourrait également renforcer la capacité de l’économie à résister aux chocs et aux ralentissements, contribuer à combler le retard du Canada en matière de productivité et d’innovation, et réduire le nombre de personnes confrontées à des difficultés financières. Ainsi, ne pas tenir compte de ce problème, c’est perdre des milliards de dollars.
Le présent rapport est l’aboutissement d’une initiative de recherche engagée que le Forum des politiques publiques a menée sur trois ans et qui s’intitule All-In: Pathways to Economic and Financial Inclusion for Canada (« tout le monde à bord : les voies de l’inclusion économique et financière au Canada »). Ce travail de recherche a abouti entre autres à la conclusion que les barrières systémiques et la discrimination sont des déterminants fondamentaux de l’exclusion économique et financière dans notre pays. Les politiques visant à remédier à ce problème doivent avoir pour objectif d’abattre les barrières, de contrer la discrimination et d’aider les personnes concernées à surmonter les difficultés qu’elles rencontrent.
Ce travail entend s’éloigner des débats actuels et de la pensée traditionnelle en examinant le problème à long terme, sous l’angle économique, pour se demander ce qui se produit lorsqu’on ne tient pas compte de l’inclusion ou, au contraire, lorsqu’on l’encourage. En nous appuyant sur le corpus de recherche établi tout au long de ce projet, nous avons entrepris une analyse prospective qui envisage trois avenirs possibles pour le Canada de l’an 2040 :
- Un avenir où l’inclusion économique et financière est remise en cause;
- Un scénario où l’inclusion économique et financière progresse;
- Un scénario où la société canadienne connaît un changement transformationnel permettant une pleine inclusion économique et financière.
Sur la base des conclusions de l’analyse prospective, de la recherche originale et des consultations de spécialistes, nous présentons trois grandes recommandations aux stratèges politiques :
1. Renverser le cours des choses en matière d’inclusion et de politique économique
Pour parvenir à l’état de transformation que représente une inclusion économique et financière complète – et pour réaliser les gains énormes qui en découlent –, nous devons modifier radicalement notre compréhension de la relation entre l’inclusion et la prospérité économique et, par extension, notre démarche globale d’élaboration de la politique économique.
La prospérité économique n’est pas une condition préalable à l’inclusion économique et aux possibilités égales pour tous. C’est au contraire l’inclusion économique qui est un moteur fondamental de notre prospérité collective et qui doit être un pilier essentiel de la politique du Canada.
Concrètement, cette prémisse signifie que les stratèges doivent envisager sous l’angle de l’inclusion les politiques visant à renforcer l’innovation, la productivité et la croissance économique.
2. Rendre les marchés du travail plus concurrentiels
Pour renverser le cours des choses, il faudrait examiner des éléments qui n’ont pas été considérés jusqu’ici comme des facteurs d’inclusion économique : en tête de liste, les marchés du travail, qu’il faudra surveiller. Plus précisément, le Bureau de la concurrence devrait s’intéresser aux marchés du travail. Des études montrent qu’une forte concurrence sur ces marchés réduit la discrimination, car les entreprises prospèrent lorsqu’elles embauchent les personnes les plus talentueuses. C’est un aspect que les stratèges politiques spécialistes du droit de la concurrence n’ont pas pris en compte jusqu’ici.
Pour remédier à cette lacune, le Bureau devrait élaborer des lignes directrices décrivant la façon dont il prévoit d’appliquer la Loi sur la concurrence sur les marchés du travail, de la même manière qu’il dispose actuellement de lignes directrices d’application concernant les fusions et les abus de position dominante. Dans ses lignes directrices, le Bureau devrait examiner le rôle que joue la discrimination par l’employeur·euse comme stratégie anticoncurrentielle visant à réduire les salaires.
3. Aider les personnes à améliorer leur « capital identitaire »
La croissance économique exige que les gens disposent d’un capital identitaire élevé, c’est-à-dire des ressources matérielles et immatérielles dont une personne a besoin pour effectuer les grandes transitions de sa vie. Il s’agit là d’une des principales conclusions de la deuxième phase de notre rapport « All-In ».
Ainsi, les stratèges politiques devraient intégrer le concept et la théorie du capital identitaire dans les politiques et les programmes sociaux.
La réforme des programmes de l’enseignement primaire, par exemple, est un moyen essentiel de promotion d’un plus grand capital identitaire. Pour favoriser ce capital chez les enfants, il est fondamental de leur inculquer l’estime de soi, le sens de la vie, la pensée critique et les capacités de raisonnement, ainsi que la confiance en leur capacité à relever des défis.
Pour aider les adultes à cultiver un plus grand capital identitaire, les stratèges politiques peuvent tabler sur la réforme des programmes provinciaux d’aide sociale. Par ailleurs, il est possible de s’appuyer sur la formation à l’emploi pour aider les gens à renforcer leur confiance, leur estime de soi et d’autres composantes du capital identitaire.
Remerciements
Le projet All-In: Pathways to Economic and Financial Inclusion du Forum des politiques publiques est une initiative de recherche engagée en plusieurs phases qui s’étend sur plusieurs années; il vise à acquérir une compréhension approfondie de l’inclusion économique et financière et à engager les parties prenantes à l’échelle nationale dans l’élaboration de mesures pratiques visant à éliminer les plus importants obstacles (existants ou émergents) au bien-être économique et à la richesse.
La rédaction de cet article n’aurait pas été possible sans le généreux concours des membres du conseil consultatif et des autres personnes ayant participé aux groupes de discussion; nous les remercions sincèrement pour leurs contributions inestimables et leurs conversations éclairées. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance à Ron Memmel, spécialiste de la prospective, ainsi qu’à Eloise Duncan, fondatrice et cheffe de la direction du Financial Resilience Institute, pour leurs précieuses contributions.